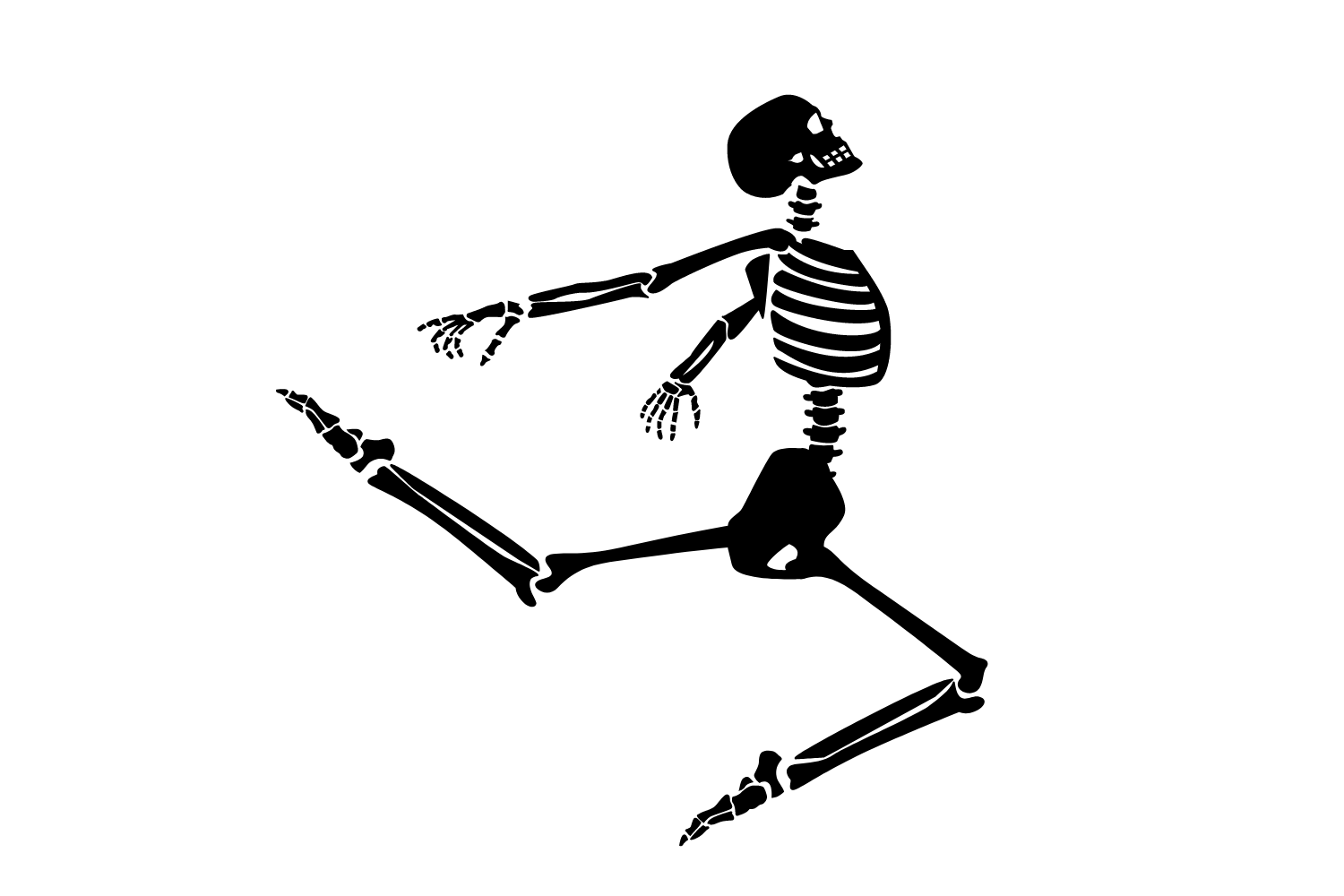Une telle confusion, loin de permettre une restauration réelle de la santé ne fait, d’après Trungpa, que reconduire l’état qui a précisément occasionné la maladie ! De sorte que la guérison ne se trouve pas là où l’on croyait pouvoir la trouver : le médecin estime souvent avoir achevé son travail au moment où il est venu à bout des signes pathologiques pour lesquels, il est vrai, le malade était venu le consulter, quand il a surtout ainsi fait taire le message parfois salutaire que représentait la maladie. (voir aussi Moyse D., Bien naître- bien être- bien mourir, érès 2001)
Car la maladie n’est pas d’abord un raté du corps/machine. Elle apparaît comme le signe de ce que, à travers le symbole de La peste, Albert Camus avait identifié de son côté comme l’expression d’un certain « divorce entre l’homme et sa vie », qui définit en l’occurrence, dans l’oeuvre de Camus, « le sentiment de l’absurdité » (La peste, Gallimard, 1947). Or, si l’hypothèse du maître spirituel et, implicitement, celle du romancier sont vraies, la médecine, trop exclusivement mobilisée par la recherche de « traitements », devrait se réformer en profondeur, pour aboutir à de réelles guérisons. Puisque la maladie peut apparaître comme un symbole, ainsi que Camus le laisse entendre en faisant de « la peste » une figure allégorique, cela indique qu’elle renvoie, comme n’importe quel symbole, à quelque chose de plus vaste qu’elle-même. C’est sur cet ensemble qu’il faudrait agir pour soigner, à plus forte raison, pour guérir.
Or, l’homme serait malade, estime Trungpa (comme Camus), d’un certain rapport à la vie. Inutile, donc, de songer à rétablir vraiment la santé sans travailler ce rapport. Quelle en est alors la tonalité ? celle d’un certain manque d’intérêt, d’attention vis-à-vis de soi-même. « Qu’on ait été renversé par une voiture ou qu’on ait attrapé un rhume, il y a un moment où l’on n’a pas fait attention à sa personne », dit-il. Bien entendu, il peut y avoir toutes sortes de raisons qui aboutissent à une telle distraction, et ce serait réintroduire l’idée, déjà trop enracinée dans nos esprits, que la médecine est toute puissante, que de la croire à elle seule capable de résoudre l’ensemble des facteurs qui ont détraqué les malades, c’est-à-dire, suivant l’étymologie éclairante de ce mot, qui les ont amenés à perdre leur propre trace.
Car c’est tout au contraire un mouvement reconduisant la médecine au sens de l’humilité qui pourrait, suivant l’hypothèse du penseur tibétain, l’amener à une réforme telle qu’elle aboutirait peut-être à de véritables guérisons. Trungpa postule en effet que « la relation de guérison est la rencontre de deux esprits », celle du médecin et du malade, et que cette rencontre ne peut avoir lieu que si l’un et l’autre prennent acte de « l’expérience commune de la naissance, de la vieillesse, de la mort et de la peur qui les sous tend »… Il est bien sûr plus confortable de « regarder de haut le patient et sa maladie en pensant que vous avez bien de la chance de ne pas souffrir de ce mal ». Mais, « l’attitude adoptée face à la mort <étant jugée> de première importance », c’est pourtant en aidant le patient à envisager cette possibilité commune que pourrait « débuter le processus de guérison ». A ce propos, « il n’est pas nécessaire, dit Trungpa, de s’efforcer de cacher ce qui est difficile à annoncer ». Ce qui n’implique pas qu’on doive non plus, suggère-t-il, assener la probabilité de sa mort prochaine au malade. « On devrait <juste>… l’aider à comprendre un peu mieux l’idée de perte – la possibilité de ne plus exister et de se dissoudre dans l’inconnu. » Car éviter d’entrer dans cet horizon, c’est, paradoxalement, éviter la vie, tandis que guérir vraiment signifierait inversement « que la vie ne gêne plus le patient <et qu’il peut> faire face à la mort sans ressentiment ni attente. »
Or, proposer un tel chemin de guérison n’est autre que la proposition d’une révolution de la médecine occidentale. Fille d’une certaine conception mécaniste de la vie héritée de la philosophie cartésienne, notre médecine, incontestablement agissante à bien des égards, nous permet-elle néanmoins d’être dans un rapport à la mort autre que celui d’une ambition de toute puissance qui l’exclut de la vie ? Et peut-elle dans ce contexte aider les médecins à se projeter sur le terrain commun de la possibilité de la vieillesse et de la mort qui le rapprocherait du malade ? Pourtant, croyant se (et nous) protéger, a-t-elle envisagé le danger auquel nous nous exposons quand nous voulons tuer la mort ?
Article paru initialement le 4 janvier 2011 dans « la Croix »