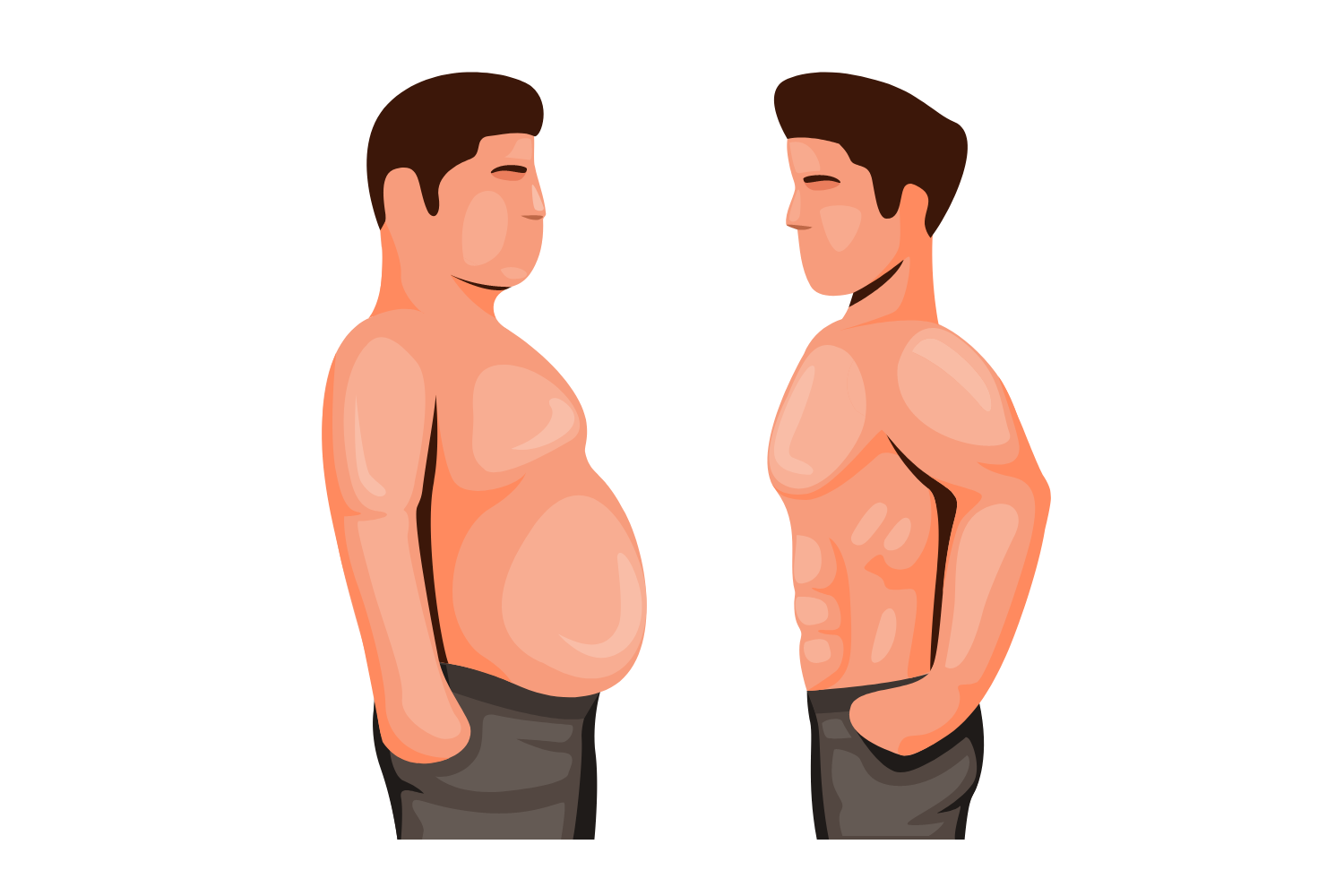On lui préférera la définition bien plus modeste qu’en a donnée René Dubos, un auteur important mais peu connu dans le monde francophone. Pour lui, la santé, telle qu’elle est perçue en tout cas, consiste simplement à pouvoir (encore) fonctionner : « Un état physique et mental relativement exempt de gêne ou de souffrance qui permet à l’individu de fonctionner aussi efficacement et aussi longtemps que possible dans le milieu où le hasard ou le choix l’ont placé »[1].
L’avantage de cette définition, qui traduit au mieux la réalité mouvante qu’est la santé[2], est qu’elle s’accorde parfaitement avec le ressenti de tout un chacun (« ça ne va pas trop mal ce matin », « je suis encore opérationnel ») tout en tenant compte de la dimension sociale, dont l’importance à notre époque ne saurait être surestimée. Si les Anciens n’aspiraient pour leur part qu’à l’harmonie naturelle (un esprit sain dans un corps sain), c’est parce que l’individu n’existait pas en dehors de la société, elle-même conçue comme un tout organique.
Si l’on parvient à travailler ou à effectuer les tâches quotidiennes « normalement », on se sentira encore adapté tout en paraissant en bonne santé aux yeux des autres, même si l’on est malade, handicapé ou souffrant[3]. Ce n’est par exemple qu’au moment où on lui interdit de conduire que la personne très âgée se sent réellement déchue. Réciproquement, c’est en reprenant le travail ou ses vieilles habitudes après avoir fait un infarctus ou subi une lourde opération qu’on a vraiment le sentiment de retrouver une vie normale, même s’il ne s’agit plus de la même normalité qu’auparavant, comme l’a montré Georges Canguilhem. Le survivant sait pertinemment que les excès lui sont désormais interdits, mais il se réjouit tout de même de reprendre le cours de sa vie, comme s’il ne s’était rien passé.
D’ailleurs, le droit à l’oubli que revendiquent de nos jours les associations de malades exprime clairement le souhait de ne pas être catégorisé comme essentiellement malade, avec la pitié pesante ou la défiance persistante que cela entraîne. Au-delà de la crainte légitime de la stigmatisation sociale, le malade, et particulièrement le malade chronique, cherche d’abord à oublier un temps ce statut (status quo ante ?) peu enviable et à se prouver à lui-même qu’il peut fonctionner aussi efficacement qu’« avant », même si cela lui demande beaucoup plus d’efforts. À défaut de se sentir très bien dans son corps, il se sent bien dans sa tête et tout à fait adapté à son environnement naturel et social.
Le seul reproche qu’on puisse faire à René Dubos est de parler encore d’« état » alors que la santé, et il est le premier à le reconnaître, n’a rien d’absolu mais varie en fonction des besoins, physiques et psychiques, et des buts de chacun. Comme il le souligne, « les imperfections et les limites de la chair et de l’esprit n’ont pas la même importance » pour un vendeur de journaux au coin d’une rue encombrée et pour le pilote d’un avion de combat supersonique, ou encore pour une mère de famille nombreuse et un mannequin du même âge[4].
Non seulement la conception qu’on se fait de la santé diffère d’un individu à l’autre, mais la perception que chacun a de l’optimum auquel il peut prétendre varie bien sûr en fonction de l’âge et des vicissitudes de la vie. Si nous sommes régulièrement amenés à revoir nos prétentions à la baisse, il arrive aussi que notre santé physique s’améliore nettement, ce qui retentit favorablement sur notre humeur générale.
La santé est en effet un processus dynamique et non un « capital » que l’on possède ou que l’on perd. Si nous aspirons tous à une meilleure santé, nous nous contentons largement d’une santé moyenne, suffisamment bonne, pour parler comme Winnicott, très en deçà en tout cas de la santé idéale, parfaite. La personne âgée se satisfait ainsi d’une toute petite santé (mobilité réduite, douleurs supportables), le malade chronique apprécie les moments, même brefs, où sa maladie lui laisse un répit. Faute d’atteindre un jour ce nirvana improbable qu’est l’« état de complet bien-être physique, mental et social » dont rêvait l’OMS au sortir d’une guerre longue et meurtrière, avec son armée mondiale d’éclopés et de traumatisés, on reconnaîtra que la santé véritable est affaire de contraste : elle connaît en permanence des hauts et des bas et se découpe toujours sur fond de maladie et de souffrance.
La notion de bien-être est déjà très relative : on peut par exemple se sentir parfaitement bien l’instant d’avant l’annonce d’une maladie grave[5] ! À l’opposé, la plupart des médecins sont désemparés lorsque leurs patients ne veulent pas admettre qu’ils sont guéris ou qu’ils ne présentent aucun symptôme inquiétant. Ils s’empressent alors de les adresser au psychologue du service…
L’injonction la plus paradoxale de notre temps est sans doute de paraître à tout prix en forme et épanoui, c’est-à-dire de dissimuler soigneusement toute espèce de mal-être. Or, cette santé triomphale complaisamment affichée est peut-être la plus fragile, comme le montrent les nombreux maux psychiques dont souffrent nos contemporains[6]. Car on a beau parler de santé globale, on continue dans les faits d’envisager à part le physique, le moral et l’environnement social, que l’on sait pourtant être parfois toxique.
Même si on la mesure et qu’on prétend l’optimiser, la santé résiste à toute objectivation ou généralisation. C’est avant tout une réalité individuelle dont le summum, certes difficile à atteindre, est cette harmonie naturelle du corps et de l’âme chère aux médecins de la tradition hippocratique – équilibre miraculeux et instable s’il en est ! Ces moments d’euphorie, de grande santé, qui égaient même les vies les plus étriquées, sont à tout prendre préférables à un constant bien-être qui, même s’il était possible, deviendrait vite ennuyeux.
- [1] René Dubos, Man Adapting, New Haven, Yale University Press, 1965, p. 351 (traduit en français sous le titre L’Homme et l’adaptation au milieu, Payot, 1973).
- [2] René Dubos prend en effet soin de préciser qu’on ne peut en donner une définition exacte (« The nearest approach to health is… »).
- [3] Seul l’arrêt maladie constitue la preuve officielle que l’on est malade, quoique les certificats soient parfois complaisants…
- [4] Cf. Man Adapting, op. cit., p. 349 (passage repris tel quel dans Man, Medicine, and Environment, New York, Praeger, 1968 ; traduit en français sous le titre L’Homme ininterrompu, Denoël, 1972).
- [5] Je dois cette idée lumineuse au Dr Alain Corvez, qui prépare un livre personnel sur la question.
- [6] Notamment le fameux burn-out, qui ne fait au fond qu’un avec le bore-out.