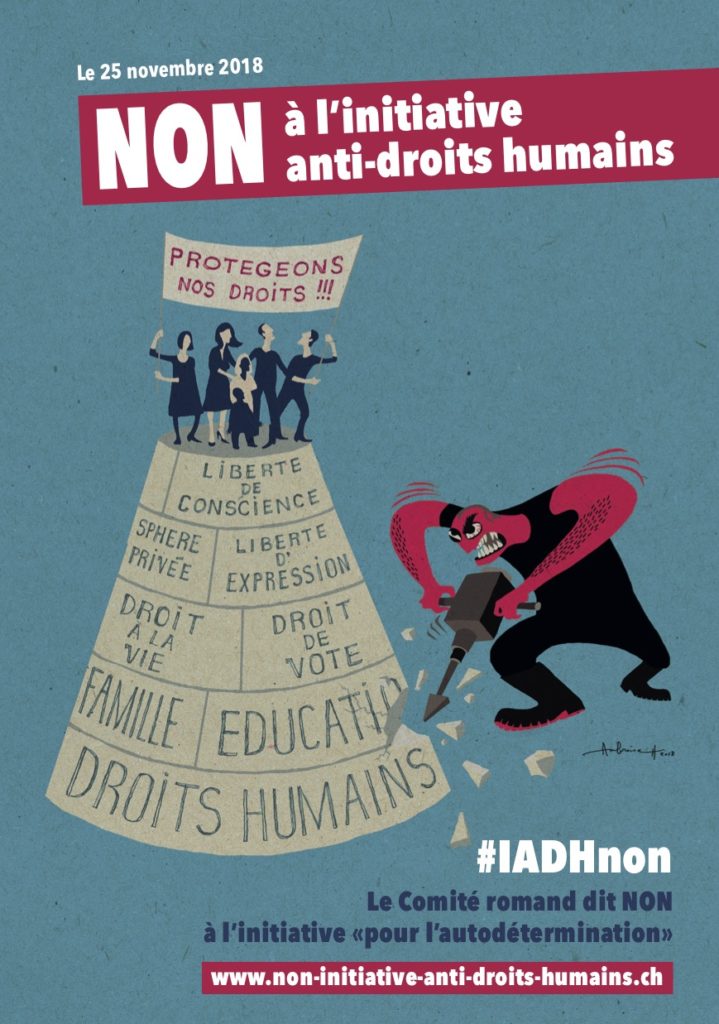Le débat tend toutefois à s'essouffler autour d’une opposition binaire. D’un coté, l’image d’une démocratie directe et imperméable à toute injonction étrangère – une insularité démocratique fantasmée. De l’autre, la crainte qu’une dénonciation de la CEDH assujettirait la Suisse à sa majorité. Le premier argument dénote un attachement viscéral à la démocratie comme procédure. Le second tend à supposer que la Cour, forcément vertueuse, ne protège que des droits forcément justifiés.
Les deux arguments sont approximatifs. L’inquiétude des premiers repose sur une prémisse légitime : le droit des droits de l’homme est une discipline embryonnaire. Les concepts dont les juges supranationaux se saisissent, tels que « dignité », « autonomie personnelle » ou « société démocratique », ne peuvent être appréhendés par le droit international classique fondé sur les intérêts mutuels des Etats. Que des juges supranationaux interprètent la Convention sans cadre de référence fait craindre qu’ils s’arrogent un pouvoir illégitime faisant fi de la volonté du peuple. C’est simple : la Suisse souveraine – entendez, le parlement – n’a ratifié qu’une convention et ses protocoles additionnels. Elle n’a pas prise sur les interprétations ultérieures des juges.
Mais c’est là négliger le rôle circonstancié de la Cour et le contenu différencié de ses arrêts. Sur ces deux plans, la Cour dispose d’atouts démocratiques. Les arrêts sur lesquelles la Cour est la plus ferme visent à consolider le processus démocratique au sein des Etats parties – celui-ci dont précisément les critiques les plus acerbes de la Cour se réclament. Un coup d’œil suffit à remarquer que la notion de « société démocratique » parsème la jurisprudence. Loin de limiter cette dernière au respect du dicton de la majorité, la Cour porte l’intensité du débat public et l’entretien de la contradiction au sommet des devoirs des Etats parties – de quoi paraphraser le « libre-marché des idées » cher à John Stuart Mill. De quoi aussi attribuer une obligation positive à la presse – le « chien de garde » de la démocratie selon Strasbourg – d’informer les citoyens, de façon plurielle et factuelle, d’un quelconque sujet d’intérêt public.
De ce point de vue, invoquer le verdict démocratique pour contester la légitimité d’une institution dont la finalité est d’en consolider les conditions de possibilité confine à la circularité. Plus encore, la Cour dispose d’un outil qui permet de ménager la ferveur démocratique : la marge d’appréciation. Selon les circonstances, la Cour se retire et laisse le soin aux Etats d’arbitrer le conflit entre droit individuel et inérêt public. C’est souvent le cas de la liberté de croyance et de religion (Article 9) lorsque la Cour estime que le consensus intra-européen n’est pas suffisant. Ceci dit, la moindre trace d’un intérêt public et de la nécessité d’en débattre prend toujours l’ascendant – toujours au nom de la démocratie.
Une défense de principe de la Cour devient quant à elle rhétorique à deux niveaux. Premièrement, la Cour ne peut maximiser deux droits qui sont en conflit. Chaque décision de Strasbourg génère un coût en termes de droits et choisir l’un au détriment de l’autre suppose une justification au-delà des droits – une justification morale. C’est là le second niveau rhétorique : les droits de l’homme ne sont pas une évidence morale. Un attachement au titulaire des droits, l’individu, ne dit encore rien sur leur finalité. Jusqu’à quel point un droit de l’homme peut être étendu en dépend. Deux des slogans d’Amnesty International, « le droit du côté des individus » et « du droit du plus fort aux droits pour tous », entretiennent justement l’idée d’une continuité naturelle. Sans critère de finalité, difficile de juger à partir de quel point « la majorité n’est pas seule » puisque toute décision démocratique implique la formation d’une minorité. Devrait-on de ce point de vue limiter les pouvoirs de Strasbourg dans son rôle de protection du processus démocratique?