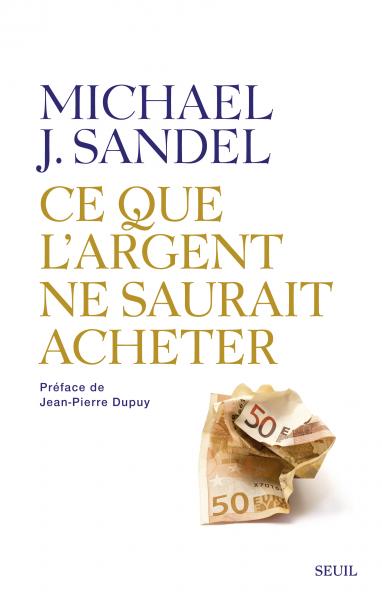Certains économistes estiment que lorsque deux individus concluent un contrat, chacun d’eux est présumé faire une bonne affaire : leur engagement mutuel, résultat d’un calcul des coûts et des bénéfices, correspond à leur utilité personnelle, qui est proportionnelle à leurs obligations contractuelles1. Ce principe est pris aujourd’hui en si bonne part que, confiné d’abord à l’analyse purement économique, il tend à régir des relations qui échappent traditionnellement à la logique marchande. Parce que chacun y trouve son compte, le marché, disent ces économistes, tient lieu de morale et il n’y a pas d’autre morale qui tienne.
Dans son livre Ce que l’argent ne saurait acheter, Michael Sandel montre qu’au contraire, il y a lieu de s’inquiéter à l’idée que, de plus en plus, nous vivrons dans une société qui non seulement dispose d’une économie de marché, mais qui devient une société de marché, c’est-à-dire une société où tout sera à vendre. Car on aurait tort de croire, nous dit l’auteur, que le marché n’affecte pas la valeur des biens et des services dont il permet l’échange. Il arrive en effet que la marchandisation évince les normes non marchandes, corrompt certains biens et en rend parfois l’accès inéquitable.
La marchandisation corrompt les biens
On pense généralement que la commercialisation d’un bien auparavant non négociable ne l’affecte pas. Sa mise sur le marché serait moralement neutre. Le marché aurait ainsi cet avantage de satisfaire les préférences individuelles en allouant efficacement les biens, sans prononcer aucun jugement moral sur ces préférences (sont-elles dignes de louange, admirables ou opportunes ?). S’il ne fait de tort à personne, chacun doit être ainsi libre d’acheter et de vendre ce qu’il veut. Il arrive même que par l’accroissement du bien-être et de l’utilité individuels, c’est le bien-être et l’utilité de la société tout entière qui sont augmentés. Et puis, disent certains économistes, en y regardant de plus près, toute action humaine – pas seulement sur le marché, mais dans la vie en général – se ramène en définitive à un calcul rationnel des coûts et des bénéfices, qui serait la seule vraie façon de choisir ce qui procure le plus de bien-être ou la plus grande utilité – et quel être humain ne recherche pas le bien-être et l’utilité2 ? En sorte que rien n’a de valeur qui n’aurait de prix, c’est-à- dire qui ne serait commercialisable3. Dans la mesure où "une économie est juste un groupe d’individus qui interagissent au quotidien" (définition de l’économiste Greg Mankiw, citée p. 146), rien ne devrait lui échapper. Mieux : "seule l’attention prêtée aux revenus et aux prix peut constituer l’assise d’une science sociale digne de ce nom" (p. 97). Ne mêlons donc pas la morale à l’économie4 et réservons nos sentiments moraux d’amour, d’altruisme, de générosité, de solidarité, à nos familles et nos amis, car ce sont des ressources rares dont il faut user avec modération.
Il semble toutefois qu’il faille revoir complètement ce constat. Les innombrables exemples présentés par Sandel (nous n’en citerons ici que quelques-uns) nous forcent de reconnaître que très souvent, et surtout dans les domaines moralement sensibles, la mise sur le marché d’un bien ou d’une pratique a un effet dégradant sur ceux-ci. Il n’est donc pas vrai, comme le croient certains, que les marchés sont de simples mécanismes5. Ils véhiculent bien des valeurs (marchandes), et il arrive que ces valeurs endommagent ou dissolvent les relations non marchandes et parfois même s’y substituent6.
Lorsque vous payez quelqu’un qui fera le pied de grue à votre place (c’est le business des "line- standers" qui fait florès aux Etats-Unis) pour retirer les billets gratuits d’un concert organisé par les pouvoirs publics, le problème n’est pas seulement que l’accès à l’événement devient payant de fait. S’il est vrai que les deux parties y gagnent (le line-stander est rémunéré et vous accédez au concert sans faire la queue), quelque chose se perd, il y a "un je-ne-sais-quoi irréductible à l’amertume des personnes déçues de n’avoir pas pu assister à un spectacle dont les places ne sont pas à la portée de leur bourse" (p. 73) : c’était une célébration civique, qui devait rendre accessible le répertoire classique à toutes les couches de la société, et elle est transformée en business lucratif. De même, lorsque des billets gratuits d’entrée à une messe du pape se trouvent, après leur distribution, mis à l’encan, c’est la dimension sacramentelle de l’événement qui est souillée7.
Autre exemple : une association américaine décide de payer des consommatrices de stupéfiants pour qu’elles se fassent stériliser et éviter ainsi les situations dramatiques de nouveau-nés intoxiqués in utero. C’est une mesure qui semble efficace et socialement utile, et même, elle ne fait de tort à personne. Il n’empêche qu’elle transformerait l’image que nous nous faisons de la procréation : les femmes toxicomanes seraient traitées comme "des machines endommagées dont la capacité de fabriquer des bébés pourrait être désactivée par une gratification pécuniaire" (p. 92). Leur capacité reproductive ne serait plus considérée comme "un don ou un mandat dont l’exercice implique de respecter les normes habituelles de responsabilité et d’affection" (p. 92).
Sandel consacre aussi quelques pages à la question du don. Pour beaucoup d’économistes, le cadeau en nature est un gaspillage : "la valeur que nous accordons aux articles qui nous sont offerts est inférieure de 20 %, par dollar dépensé, à celle des articles que nous nous achetons nous-mêmes" (dixit l’économiste Joel Waldfogel cité p. 167). La seule façon de maximiser le bien-être du destinataire est logiquement de lui offrir de l’argent : il saura s’acheter ce qui lui procure le plus grand plaisir. Mais voilà, le cadeau ne vise pas seulement à satisfaire les préférences de son destinataire. Ce n’est pas sa finalité première. On sent bien ce qu’aurait d’inconvenant un don d’argent fait à sa fiancée ou à un ami, au lieu d’un présent bien choisi. C’est que le cadeau en nature est le témoignage d’une certaine intimité, de la prévenance inhérente à l’amitié, autant de valeurs mises à mal par le don d’argent.
La corruption dont il est question dans ces exemples consiste à substituer une norme inférieure à une norme supérieure, c’est-à-dire à mesurer la valeur d’un bien ou d’une pratique sociale à l’aune d’un mode d’évaluation inférieur qui ne leur convient pas. Il est encore d’autres situations où la corruption revient à substituer une norme extrinsèque à une norme intrinsèque.
C’est le cas de ces établissements scolaires qui ont eu l’idée de payer leurs élèves pour qu’ils lisent des livres ou de ces médecins et ces compagnies d’assurances qui paient leurs patients et leurs assurés pour qu’ils restent en bonne santé (qu’ils perdent du poids, arrêtent de fumer, etc.). Dans ces deux exemples, chacun semble y gagner sans qu’aucun tort ne soit fait à personne. Pourtant, là encore, l’argument de l’innocuité du marché ne tient pas. Dans le premier cas, on voit trop que le paiement risque d’habituer les élèves à penser que la lecture est moyen de gagner de l’argent au lieu de promouvoir le goût de lire pour l’amour de la lecture. Dans le second cas, c’est le respect de soi, et l’attention qu’il faut porter à son corps qui sont menacés. Si ces pratiques nous conduisent à prendre de bonnes décisions (lire, perdre du poids, etc.), ce n’est pas pour la bonne raison (l’amour de la lecture, le respect de son corps, etc.), mais seulement pour l’argent. Le mobile monétaire évince ainsi d’autres motivations, distinctes et meilleures.
On l’a compris : il ne suffit pas que la mise sur le marché d’un bien échappant traditionnellement aux normes marchandes procure quelque utilité à ceux qui l’achètent ou le vendent, ou que ce bien soit équitablement distribué. Il faut dans chaque cas se demander si ces normes marchandes évincent ou non les normes non marchandes – la santé, l’éducation, la procréation, etc. – et, dans l’affirmative, s’il vaut la peine qu’on renonce à ces dernières au nom de notre conception de la vie et de la société bonnes.
Quant à cette idée selon laquelle nos sentiments moraux seraient des ressources rares à ne pas épuiser inconsidérément, c’est une conception économistique de la vertu et trompeuse, et qui ne fait d’ailleurs qu’alimenter la confiance dans le marché. L’amour, la générosité, la solidarité, le sens civique,… sont des vertus qui se cultivent par l’exercice et s’accroissent par l’usage qu’on en fait. Et Sandel de citer Aristote : "C’est à force de pratiquer la justice, la tempérance et le courage que nous devenons justes, tempérants et courageux".
Mais il est encore une autre conséquence de la marchandisation des biens et des pratiques échappant traditionnellement au marché. Elle a trait non pas à l’importance morale de ces biens et de ces pratiques, mais à l’inégalité que cette marchandisation peut induire.
La marchandisation rend les échanges inéquitables
En donnant plus de poids à l’argent, on creuse inévitablement le fossé entre riches et pauvres. Ce n’est pas un problème lorsqu’il s’agit de biens matériels de luxe. Mais c’en est un lorsqu’il est question d’éducation, d’influence politique, de soins de santé, de culture, etc. L’accès en est rendu plus difficile pour les personnes défavorisées et les conditions de leur engagement contractuel ne peuvent plus être considérées comme équitables.
C’est ainsi que la pratique des line-standers citée plus haut ou celle de la revente de billets gratuits, transformant des manifestations publiques et gratuites en événements payants, a conduit à l'exclusion de tous ceux qui n’en ont pas les moyens. Et lorsqu’une université prestigieuse admet l’enfant d’un riche donateur en échange d’un don important, l’accès à l’institution devient nécessairement inéquitable pour ceux "qui n’ont pas la bonne idée d’avoir des parents millionnaires" (p. 180).
On trouve encore dans le livre de Sandel l’exemple de ces personnes qui acceptent, moyennant finance, de louer leur front pour des annonces publicitaires (tatouées). Ou encore cet exemple d’une agence publicitaire qui propose aux personnes menacées de saisie immobilière de payer les traites de leur emprunt hypothécaire, en échange du droit, pour cette agence, de peindre sur tout l’extérieur de la maison des annonces publicitaires. Là encore, chacun y gagne : le publicitaire, qui dispose d’une "surface" bien visible, et celui qui est rémunéré pour la mise à disposition de cette "surface". Mis à part ce que de telles pratiques peuvent avoir d’humiliant et d’avilissant (c’est l’objection de la corruption évoquée plus haut), elles apparaissent surtout comme le moyen pour ces personnes de sortir d’une situation de détresse économique. Ces exemples montrent qu’un engagement contractuel – donc volontaire – conclu dans une situation inéquitable ne peut pas être présumé libre.
* * *
Le problème des rapports de l’économie et de la morale n’est pas nouveau. On a déjà beaucoup dit de la nécessité pour l’économie d’intégrer dans ses analyses les considérations d’ordre moral. On admet aujourd’hui que les comportements sur le marché ne s’expliquent pas par la seule rationalité marchande, que l’utilité individuelle n’est pas le seul mobile de l’action et que lorsque celle-ci n’est pas rationnelle, elle n’est pas forcément déraisonnable. Mais en critiquant l’utilitarisme et sa prétention hégémonique à expliquer les comportements humains, Michael Sandel ne cherche pas à replacer au cœur de l’économie la morale, mais bien plutôt à préserver la morale de l’économie.
S’il y a des choses qui ne s’achètent pas, il y en a d’autres que la marchandisation corrompt, quand elle n’en rend pas l’accès inéquitable. Il ne suffit donc pas qu’une transaction soit avantageuse pour chaque partie et qu’elle ne nuise pas aux tiers : il y a lieu de se demander si, en fixant un prix à des choses qui n’en ont pas, on n’en met pas en péril la valeur. Sandel nous fait voir dans son ouvrage l’urgence qu’il y a de se saisir de la question morale et de replacer au cœur du discours public ce que le marché tend à évincer : notre représentation de la vie bonne et de la bonne société8. Tout concurrentes que peuvent être nos conceptions à ce sujet, on ne peut pas feindre qu’elles ne comptent pas9. L’auteur se garde d’ailleurs d’en proposer un modèle. Le principal mérite de son livre est de nous montrer au travers de très nombreux exemples tirés de l'actualité, le danger que nous courons en laissant le marché décider de notre mode de vie à notre place.
C’est que, n’en déplaise aux tenants du libre marché, toutes les préférences individuelles ne se valent pas10, surtout lorsqu’il s’agit de choses moralement sensibles comme la santé, l’éducation, la procréation, …11 En quoi les utilitaristes ont tort, qui professent la maximisation de toutes les préférences individuelles indépendamment de leur valeur morale12.
Rien de surprenant, en réalité, sous la plume d’un communautarien. Sandel est en effet de ceux pour qui les pratiques et les compréhensions partagées dans une société comptent autant, si ce n’est plus, que cette justice dont les libéraux ont fait "la première vertu des institutions sociales"13. En regrettant la rareté d’arguments moraux dans nos mœurs politiques et la vacuité morale et spirituelle du discours public, c’est à une attention accrue au bien commun que nous convie Sandel. Le bien commun, tel que le conçoivent les communautariens, ne passe pas seulement par la distribution équitable de droits individuels. Il a trait à une conception d’un mode de vie considéré comme supérieur.
Le livre de Sandel traite moins des valeurs à préserver que de ce qui les menace, et, de ce point de vue, la thèse qu'il défend n’est pas si originale. Les effets de l'extension de l'échange marchand aux activités intersubjectives ont déjà été étudiés notamment par Lukács ou Honneth14 et ce que Sandel dénonce dans son livre s'apparente en dernière analyse à la réification des relations sociales15. Le succès que connaît ce livre s’explique selon nous d’abord par le fait qu’il s’adresse au grand public dans un langage simple et qu’il recourt très peu à l’argumentation théorique, mais privilégie largement l’exposé par l’exemple.
Notes
1 Cette idée est au fondement de la théorie "standard" de l’échange marchand : cf. Gilbert RIST, L’économie ordinaire entre songes et mensonges, Paris, Presses de Sciences Po, 2010, p. 94 s.
2 On sait le crédit dont a bénéficié l’hypothèse selon laquelle la maximisation de l’intérêt personnel représente une bonne approximation du comportement humain : cf. Amartya SEN, Éthique et économie. Et autres essais (trad. de l’anglais par S. Marnat), Paris, PUF, 1993, p. 49.
3 Ce n’est rien de nouveau : cf. Serge LATOUCHE, La déraison de la raison économique. Du délire d’efficacité au principe de précaution, Paris, Albin Michel, 2001, p. 79, citant Bentham : "La seule commune mesure que compte la nature des choses, c’est l’argent", ou encore : "L’argent est l’instrument qui sert de mesure à la quantité de peines et de plaisirs. Ceux que ne satisfait pas l’exactitude de cet instrument devront en trouver quelque autre plus exacte, ou dire adieu à la politique et à la morale".
4 La séparation de l’économie et de la morale ne date pas d’hier ; elle s’est opérée déjà dans les théories d’Adam Smith : cf. Peter KOSLOWSKI, Principes d’économie éthique (trad. de l’allemand par A. Saada), Ed. du Cerf, Paris, 1998, p. 24 ; cf. aussi ibid., p. 25 : "La séparation de l’éthique et de l’économie est une conséquence du triomphe de la cosmologie mécaniciste de l’époque moderne et de ses répercussions depuis Hobbes et Mandeville sur l’économie […] et la raison pratique se trouve réduite à la seule intériorité de la moralité, à la pure volonté".
5 Ils le sont également, et il ne s’agit sans doute pas de rejeter complètement la conception mécaniste de l’économie. Cf. Amartya SEN, op. cit., p. 11 : "Dans nombre de cas, la science économique est en mesure d’offrir une meilleure compréhension et un éclairage utile, précisément parce qu’elle fait largement appel à une conception mécaniste".
6 Cf. Serge LATOUCHE, "L’économie est-elle morale ?", in : Revue du MAUSS, N. 15 (2000), Éthique et économie, Paris, La Découverte, p. 74 s. (ci-après : "Serge LATOUCHE, L’économie est-elle morale ?") : "L’économie moderne désenchante le monde en expulsant les valeurs des objets. En réduisant l’univers des créatures à celui d’une production d’utilités, le marché mondial dégrade l’éthique elle-même […]. Le rapport d’échange naturel M-A-M (marchandise-argent-marchandise), vendre ses surplus pour acheter ce dont on a besoin, se corrompt en rapport marchand A-M-A’, acheter le moins cher possible pour revendre le plus cher possible et gagner de l’argent. Ce renversement lui [il s’agit d’Aristote] paraît éminemment condamnable, non seulement parce qu’antinaturel, mais plus encore parce qu’anticivique".
7 Ce ne sont là que deux des nombreux exemples par lesquels Sandel montre les conséquences de situations où le marché se substitue aux modes non marchands d’allocation des biens (dans ces deux exemples, l’attente, dans d’autres cas, le mérite, le sort, etc.).
8 C’est précisément ce que l’idéologie libérale cherche à éviter : cf. Jean-Claude MICHÉA, La double pensée – Retour sur la question libérale, Paris, Flammarion, 2008, p. 204 : "L’obsession principale des libéraux […] a toujours été de découvrir des systèmes de pilotage automatique de la société […] qui rendraient définitivement inutile le gouvernement « idéologique » des hommes (c’est-à-dire toute prétention à les gouverner au nom d’une conception particulière du salut ou de la « vie bonne »)".
9 C’est notamment ce que Sandel a reproché à Rawls qui, pour résoudre la difficulté que pose la concurrence des valeurs individuelles, donne la priorité au juste sur le bien.
10 Cf. Serge LATOUCHE., L’économie est-elle morale ?, p. 86 s. : "[…] la réduction des sensations à la seule utilité [est] problématique. Quelle mesure commune, en dépit de Bentham, entre les plaisirs de la chair et des sens, les joies du cœur et les satisfactions de l’esprit ? A l’intérieur de chacune de ces grandes catégories peut-on même trouver un étalon ? Avec quelle unité comparer les plaisirs de la table et ceux de la luxure ? Est-il sûr que le choix d’un vin blanc ou d’un vin rouge traduise des différences d’utilités […] ?"
11 C’est une conception objectiviste de la morale, qui reste bien sûr problématique. Cf. Amartya SEN, op. cit., p. 40, "la controverse sur l’objectivité […] n’est pas résolue par le fait de reconnaître l’importance de l’action [c’est-à-dire en reconnaissant la capacité d’une personne à concevoir notamment des buts, des engagements ou des valeurs]".
12 Cf. Amartya SEN, op. cit., p. 21 s. : "La véritable question est de savoir s’il existe une pluralité de motivations, ou si l’intérêt personnel est le seul motif qui guide les êtres humains" ; cf. aussi ibid., p. 45 : "[…] puisque la thèse de l’utilité en tant que seule source de valeur repose sur l’assimilation de l’utilité et du bien-être, on peut la critiquer pour deux raisons : 1/ parce que le bien-être n’est pas la seule valeur ; 2/ parce que l’utilité ne représente pas correctement le bien-être" ; Serge LATOUCHE, L’économie est-elle morale ?, p. 83 : "L’utilité étant un concept vide, la maximisation des utilités peut paraître somme toute un objectif raisonnable […]. Cependant, ce potentiel que l’on maximise n’est raisonnable qu’à condition d’avoir par-devers soi un projet pour l’utiliser. Le bonheur reste le but, non la maximisation des moyens susceptibles de le procurer. […] la rationalité dévore son objet dans la procédure. Cette procédure d’optimisation enlève aux enjeux toutes les qualités qui font les saveurs de la vie, par la réduction à une grandeur homogène. L’utilité n’est utile que pour accroître les utilités."
13 John RAWLS, Théorie de la justice (trad. de l’américain par C. Audard), Paris, Le Seuil, 1971, p. 29.
14 Cf. Georg LUKÁCS, Histoire et conscience de classe (trad. de l’allemand par K. Alexos et J. Bois), Paris, Minuit, 1960 ; Axel HONNETH, La réification. Petit traité de Théorie critique (trad. de l'allemand par S. Haber), Paris, Gallimard, 2007. Il faut évidemment encore citer Georg SIMMEL, Philosophie de l’argent (trad. de l’allemand par S. Cornille et P. Ivernel), Paris, PUF, 2014, qui analyse les effets de la monétarisation, observant notamment comment, dans les sociétés modernes, les considérations finalistes liées à notre destinée individuelle et collective sont peu à peu écartées.
15 Cf. HONNETH, op. cit., p. 22 : "Dans l’échange marchand, les sujets se contraignent réciproquement (a) à ne percevoir les objets donnés que comme des « choses » dont ils pourront éventuellement tirer profit, (b) à ne voir leurs partenaires que comme les « objets » d’une transaction intéressée, et (c) à ne se rapporter à leurs propres facultés qu’en tant que « ressources » supplémentaires dans le cadre du calcul des opportunités de profit". Il est vrai que le concept de réification chez Lukács n'a pas une signification éthique mais seulement ontologique. Il n'empêche qu'elle possède un contenu normatif (cf. ibid., p. 18).