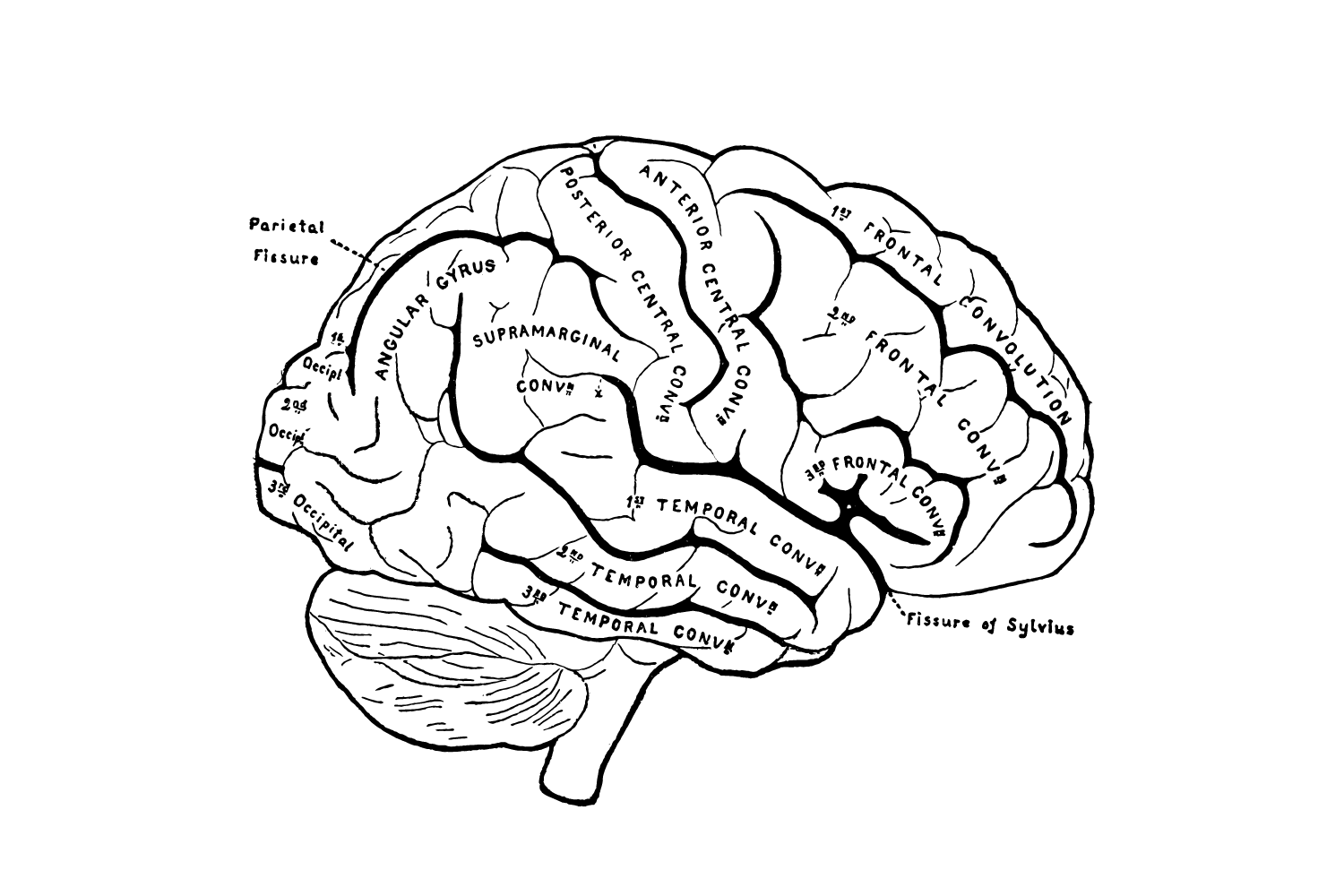S’ils étaient hospitalisés, la consigne était de cesser de dire qu’ils entendaient cette voix et de continuer à se comporter normalement. La majorité des volontaires furent hospitalisés, certains jusqu’à près de deux mois.
Cette étude et d’autres, dont le film Vol au dessus d’un nid de coucous s’est fait l’écho, avaient à l’époque conduit à une sévère remise en cause de la rigueur des connaissances psychiatriques. La réaction n’a pas tardé. Dès 1980, l’association américaine de psychiatrie publiait la troisième version de son Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, connu sous le nom de DSM-III, qui répertoriait tous les troubles mentaux qu’un professionnel pouvait diagnostiquer, et en fixait les critères. Impossible désormais pour un psychiatre d’interner un patient sans pouvoir justifier des signes qu’il a observés rigoureusement et en nombre suffisant. Progressivement, la psychiatrie s’est également détournée de la psychanalyse pour embrasser les neurosciences cognitives. La recherche en psychiatrie préfère désormais scruter les effets biologiques des médicaments antipsychotiques, que raffiner les constructions théoriques sur les processus psychologiques sous-jacents des troubles mentaux.
C’est dans ce contexte que la philosophie de la psychiatrie contemporaine s’est construite. Alors que l’ancienne génération s’intéressait à la manière dont les préjugés de la société influencent le jugement des professionnels de santé, les philosophes de la psychiatrie s’intéressent désormais à des formes plus sophistiquées de surmédicalisation de l’existence ordinaire et des problèmes de vie. Une entreprise philosophique consiste ainsi à examiner la solidité de diverses catégories de troubles mentaux. Par exemple, pourquoi doit-on considérer comme pathologique un comportement « dépressif » ? N’y a-t-il pas certains contextes, comme le deuil, une grave déception amoureuse ou un échec professionnel, où un tel comportement est au contraire normal ? De manière plus générale, les philosophes s’interrogent aussi sur ce qu’est, à tout prendre, un « trouble mental ». Certains philosophes s’intéressent enfin avec certains psychiatres à la manière même dont on s’y prend pour définir les différents troubles mentaux, c’est-à-dire, par des associations de symptômes possibles. A quel point est-ce fiable ? quelles seraient les alternatives ?
De l’autre côté, beaucoup de philosophes de la psychiatrie s’intéressent de près aux apports des sciences exactes, notamment de la neurobiologie, de la génétique et des neurosciences cognitives. Les comportements humains sont sans doute des indicateurs peu fiables de troubles mentaux qui ne sont pas aussi facilement observables que les effets de la varicelle, de l’angine ou du diabète. Ne pourrait-on pas justement définir les troubles mentaux biologiquement – les médecins disent : « par des biomarqueurs » ? Cette prétention, mainte fois répétée dans la grande presse, n’est pourtant encore, à ce jour, guère davantage qu’un programme de recherche. Les philosophes s’interrogent donc sur la possibilité de principe de parvenir un jour à définir des troubles mentaux par des dysfonctionnements neurobiologiques. Certains ont fait valoir qu’aussitôt un état pathologique défini par un dysfonctionnement neurobiologique, comme la démence sénile le fut par la présence de plaques amyloïdes dans le cerveau des patients atteints de la maladie d’Alzheimer, cet état cesse d’être conçu comme un trouble mental et devient un trouble neurologique. D’autres se sont demandés si, par recoupement des observations des cliniciens et de celles des biologistes, on peut progressivement dégager la vraie nature d’un trouble mental donné, c’est-à-dire à la fois ses causes et les symptômes par lesquels il se manifeste. Plus récemment, certains philosophes de la psychiatrie se sont intéressés à l’importation en psychiatrie de méthodes sophistiquées d’investigation « génomique », d’algorithmes informatiques de traitement de données massives, ou de diverses techniques interventionnelles de stimulation cérébrale localisée. Le moins que l’on puisse dire, est qu’elles ne viennent pas enrichir et développer une science déjà mûre, mais sont plutôt conçues comme un moyen de sauver la mise à une révolution scientifique qui semble parfois faire du surplace.
Les philosophes de la psychiatrie partagent le même objectif ultime que les psychiatres : améliorer la situation de ceux qui souffrent de ce que l’on appelle des « troubles mentaux ». Les moyens diffèrent, mais ils ne divergent pas nécessairement. Il ne s’agit pas pour un philosophe de prendre en charge des individus, ni de chercher le mécanisme de tel trouble mental, schizophrénie, autisme, dépression, trouble obsessionnel compulsif. Il s’agit de donner toute sa place au doute raisonnable dans une discipline somme toute assez jeune, et assurément sensible pour tout un chacun. Personne n’a envie d’être laissé à ses souffrances si elles peuvent être allégées ; personne n’a envie d’être considéré toute sa vie comme quelqu’un de malade, s’il n’y a rien de pathologique dans son comportement.