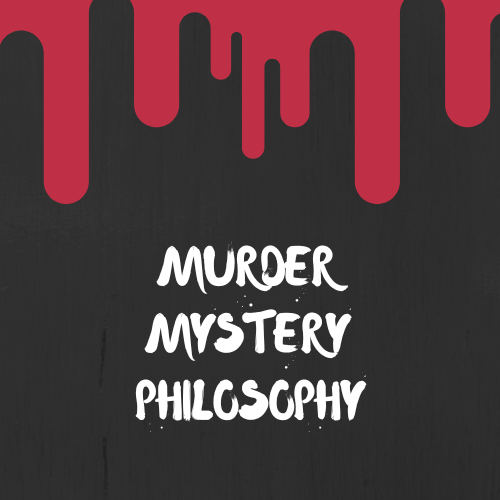Une provocation sophistique
Dans l’Euthydème, Platon met en scène une rencontre entre Socrate (accompagné de son ami Ctésippe) et deux frères qui se piquent d’enseigner l’amour et la vertu, Dionysodore et Euthydème. Ceux-ci font la démonstration de leur habileté rhétorique à travers plusieurs arguments, dont certains concernent l’éducation d’un jeune homme, Clinias. Voici l’un de ces arguments, peu commenté :
Dionysodore : Fais attention, Socrate, à ne pas bientôt nier ce que tu affirmes maintenant.
Socrate : J'ai bien pris garde à ne jamais me retrouver à le nier.
D : Quoi donc ? Tu dis vouloir que cet élève devienne savant [1]?
S : Tout à fait.
D : Mais à présent, ce Clinias, est-il savant ou non ?
S : Du moins dit-il que pas du tout ; il n'est, je crois, guère fanfaron.
D : Mais vous voulez qu'il soit savant et non pas ignorant.
S : Nous sommes d'accord.
D : Alors vous voulez qu'il devienne ce qu'il n'est pas, et qu'il ne soit plus ce qu'il est à présent.
Et moi, [raconte Socrate,] en entendant cela, j'étais troublé, et prenant son parti de mon trouble, il dit :
« Quoi donc ? Puisque vous voulez qu'il ne soit plus ce qu'il est à présent, vous voulez, semble-t-il, l'anéantir ? Voilà donc vraiment de dignes amis et amants, eux qui feraient par-dessus tout mourir leur cher adolescent ! » [2].
S’ensuit alors la colère de Ctésippe, qui accuse Dionysodore de le calomnier ; Euthydème entreprend alors de montrer qu’il est impossible de dire le faux, par un autre argument. Ctésippe finira par retourner le jeu de la mauvaise foi contre les frères enseignants, en redoublant de sophismes. De fait, l’argument de Dionysodore traduit ci-dessus est souvent lu comme un paralogisme de bas étage, pour au moins trois raisons :
1) Intuitivement, il semble assez évident qu’on peut bel et bien souhaiter éduquer quelqu’un sans souhaiter sa mort, tout comme on éduque effectivement la plupart des enfants sans les tuer.
2) Formellement, l’argument semble reposer sur l’inférence suivante : (a) C est ignorant et non savant ; (b) S veut que C ne soit plus ignorant et qu’il soit savant; (c) n’être plus revient à être anéanti ; (d) donc S veut que C soit anéanti. L’argument, en fait, n’a même pas besoin que S veuille que C soit savant, il suffit que S veuille que C ne soit plus ignorant (ou n’importe quel autre prédicat). (a), (b) et (c) sont tout à fait plausibles. Cependant, (a) et (b) concernent le sens prédicatif de « être » (en l’occurrence, ignorant et savant sont des états ou des qualités possibles de C), tandis que (c) et (d) concernent le sens existentiel (être tout court, c’est-à-dire exister). L’inférence est invalide puisque ses prémisses portent sur des sens différents de « être ». Même si « être mort » est bien une qualité, elle n’est déduite que comme synonyme de « être anéanti » ou « n’être plus » : la déduction de la qualité « être mort » n’a pu se faire qu’en passant par le sens existentiel.
3) Textuellement, la plupart des autres arguments présentés par Dionysodore et Euthydème dans le dialogue sont des paralogismes fondés sur le double sens des mots (et parfois dénoncés comme tels par Socrate). Il est donc raisonnable de s’attendre à ce que cet argument particulier ne soit qu’un exemple supplémentaire de tels paralogismes verbaux.
Le cotexte permet-il de disqualifier l’argument ?
Toutefois, aussi raisonnable soit ce dernier point, il devrait plutôt nous inciter à la prudence. Il y a une dangereuse facilité exégétique à postuler que les diverses étapes d’un traité philosophique (même celles où sont mis en scène les adversaires de l’auteur) ne sont que l’inlassable répétition d’une même thèse ou d’un même procédé (para)logique. Une élémentaire charité herméneutique exigerait plutôt d’au moins examiner pourquoi Platon éprouve le besoin d’illustrer plusieurs fois un même problème, de répéter une réfutation qui aurait pu suffire à elle seule.
D’ailleurs, l’argument qui suit immédiatement (celui sur l’impossibilité de dire le faux) a beau reposer sur le même genre de logique fallacieuse, il est loin d’être insignifiant pour Platon. En effet, une part importante des développements de deux dialogues majeures, le Sophiste et le Théétète, sera consacrée à soigneusement fonder la possibilité d’un discours faux, contre une version plus élaborée de l’argument d’Euthydème. Dès lors, on ne peut tirer argument du cotexte (fait de paralogismes verbaux) si ce cotexte contient également des arguments que Platon prend par ailleurs au sérieux, fût-ce sous une forme augmentée et dans d’autres dialogues. La raison 3) est donc insuffisante pour réduire l’argument de Dionysodore à un paralogisme sans intérêt.
L’analyse formelle permet-elle de disqualifier l’argument ?
Qu’en est-il de la raison 2) ? Tel que formulé, l’argument est bien un paralogisme. Notons d’ailleurs qu’en grec, ce n’est pas seulement sur le verbe être que joue Dionysodore, mais aussi sur le sens du pronom relatif ὅς, d’abord pris dans son sens qualitatif (« tel que Clinias est », donc comme un synonyme de οἷος), puis dans son sens propre (« ce que Clinias est ») [3]. S veut que C ne soit plus tel qu’il est, d’où Dionysodore infère (fallacieusement) que S veut que C ne soit pas ce qu’il est, c’est-à-dire soit anéanti. On peut raisonner en bon aristotélicien sur la différence entre être d’une certaine qualité, être quelque chose et exister. Mais précisément : cette distinction est-elle toujours aussi tranchée que l’affirmeront plus tard les Catégories et la Métaphysique d’Aristote ? L’inférence de Dionysodore est un paralogisme dans la mesure où il passe d’un premier sens de ce que reconnaît Socrate (vouloir que Clinias ne soit pas ce qu’il est, c’est-à-dire pourvu de la qualité « ignorant ») à un second (vouloir que Clinias ne soit pas ce qu’il est, c’est-à-dire Clinias avec l’ensemble de ses déterminations), puis à un troisième (vouloir qu’il n’y ait plus de Clinias), en présentant cet enchaînement comme une inférence logique, qui suppose l’univocité pour être valide. Le Dionysodore du dialogue, pressé de l’emporter sur ses interlocuteurs à n’importe quel prix, a pu se contenter de ces assimilations rapides.
En revanche, posons un instant un Dionysodore qui se soucierait un peu moins d’éristique et un peu plus d’élaboration philosophique. Il pourrait commencer par contester la séparation franche entre « Clinias tel qu’il est » et « ce qu’est Clinias ». Il pourrait même décider de ne pas entrer dans toute la complexité d’un débat métaphysique sur le rapport entre l’essence d’un objet et l’ensemble de ses propriétés, pour plutôt se concentrer sur le sujet précis qui est celui de son argument : l’éducation. Il pourrait ainsi contester le bien-fondé d’une différence radicale entre « chercher à ce que quelqu’un ne soit plus ignorant » et « chercher à ce que quelqu’un ne soit plus ce qu’il est » [4]. Une stratégie pour ce faire serait par exemple de refuser d’accorder que l’ignorance de Clinias se limite à une propriété accidentelle complètement séparée de sa personnalité, de son essence, ou de quoi qu’on puisse intégrer dans « ce qu’est Clinias ». Au contraire, pourrait dire ce Dionysodore, Clinias à un temps t ne peut être valablement décrit, voire défini, sans tenir compte des aspects majeurs de son rapport au monde et de ses connaissances. Sans doute bien des traits que l’on souhaiterait inclure dans « ce qu’est Clinias » (considéré comme individu, non comme simple représentant de l’espèce humaine) — par exemple sa manière de penser ou d’agir — se présenteraient fort différemment si son état cognitif général devait suffisamment évoluer pour qu’on puisse considérer qu’il est passé d’« ignorant » à « savant ». Autrement dit, Clinias savant ne serait, à bien des égards, pas exactement la même personne que Clinias ignorant. Dans cette mesure au moins, il est sensé de dire que vouloir que Clinias cesse d’être ignorant, c’est vouloir qu’il cesse d’être qui il est, c’est-à-dire « ce qu’il est ». Le passage du premier au second sens de ὅς n’est donc pas nécessairement si fallacieux qu’il y paraît.
Peut-on en dire autant du second passage, celui de « vouloir que Clinias ne soit plus ce qu’il est » à « vouloir que Clinias soit anéanti » ? Là aussi, une lecture charitable est possible. Elle anticiperait quelque peu sur les paradoxes de l’identité chez Plutarque et Locke, dont le plus connu est le bateau de Thésée. Dans une conception forte de l’identité, Clinias n’est identique à lui-même que pour autant que l’ensemble de ses propriétés (ou de ses propriétés essentielles) est préservé à l’identique. Or, si Clinias ignorant devient, tout d’un coup ou progressivement, Clinias savant, c’est-à-dire Clinias pourvu d’un nouvel état d’esprit et d’un nouveau rapport à lui-même et au monde, on peut alors dire que Clinias ignorant n’est plus, que ce Clinias n’existe plus. Il a été remplacé par un nouveau Clinias, pourvu en partie des mêmes propriétés que l’ancien, mais avec de substantielles différences, celles liées à son nouvel état de savant. Autrement dit, il s’agirait d’arguer que « vouloir que Clinias cesse d’être ce qu’il est » peut se traduire par « vouloir que Clinias 1 soit anéanti au profit de son remplacement par Clinias 2 », ce qui est une façon provocatrice mais non absurde de modéliser la transformation cognitive et morale [5].
L’éducation fait cesser d’être ce qu’on est
Notons en effet qu’il ne s’agit pas ici seulement du passage insensible du temps (comme dans certaines versions des paradoxes sur l’identité personnelle), mais bien d’une transformation souvent décrite comme un changement profond et radical. Passer d’ignorant à savant (ou « sage », ou même « éduqué ») implique une altération particulièrement importante, souvent comparée à une conversion. C’est certainement le cas de l’éducation scolaire telle que nous la pratiquons dans nos sociétés : l’école valorise un certain ensemble de connaissances, d’attitudes et de normes que l’on peut appeler une culture scolaire. Elle prépare plus ou moins directement à un rôle social d’étudiant ou de professionnel, qui se caractérise par une identité propre à ce rôle et par les manières d’agir et de penser qui lui conviennent. Cela passe souvent par le déploiement normatif de logiques et de références considérées comme seules légitimes, ou à tout le moins comme plus pertinentes que d’autres pour le rôle visé. Ainsi y consultera-t-on le Larousse plutôt que Wikipédia, la liste des lauréats du Goncourt plutôt que Metacritic, la démonstration et les schémas du manuel plutôt que la vulgarisation d’un youtubeur, et ce même dans une perspective non fiabiliste, c’est-à-dire indépendamment de la qualité des résultats obtenus par la consultation ces différentes sources. La sociologie de l’éducation pourrait démultiplier les exemples. Il n’est pas nécessaire d’adhérer à l’idéologie bourdieusienne de la reproduction sociale dans toute sa radicalité et ses présupposés marxistes pour constater que, la plupart du temps, les attitudes valorisées par l’école sont sensiblement différentes de celles déployées par la majorité des élèves, que ce soit spontanément ou sous l’influence de leur milieu de socialisation originaire.
Il y a un sens à considérer cette confrontation comme une violence symbolique infligée aux élèves par l’institution scolaire. Les codes culturels des élèves sont, dans des proportions variables, considérés comme non pertinents, voire comme des obstacles à surmonter. Les élèves sont invités à en adopter de nouveaux, et à y conformer leurs attitudes. Cette invitation peut avoir des accents déchirants : l’institution dit à l’élève que sa culture, celle de ses amis et parents, n’est pas la bonne, qu’elle est incorrecte (et même « fautive »), qu’il doit y renoncer. L’élève se retrouve sommé de choisir entre la culture de ses proches et celle de l’école, entre la trahison et le rejet du cadre [6]. Une telle situation ne se rencontre pas seulement dans une perspective d’assimilation culturelle des minorités. L’initiation à une profession, à une discipline sportive ou artistique, et même à toute pratique codifiée qui ne soit pas strictement identique au quotidien de l’élève, tout cela exige de lui qu’il reconfigure ses manières d’agir et de penser pour espérer faire un jour les choses correctement. Dans chacun de ces cas, celui qui apprend est un étranger dans un pays aux règles mystérieuses ; il y devra s’accoutumer et même s’assimiler.
Aussitôt que l’on considère que l’apprentissage ne se réduit pas intégralement à l’acquisition de compétences totalement séparables de l’individu (à la manière dont un ordinateur installe et exécute un programme sans être modifié par lui), mais implique une transformation du sujet connaissant, on doit bien admettre qu’on attend de ce sujet qu’il devienne autre que ce qu’il est pour l’instant. On pourrait chercher à nuancer cette conclusion en distinguant les transformations cognitives de celles qui seraient d’ordre culturel ou moral. Mais on serait alors en peine de trouver des exemples indiscutables de cette distinction : apprend-on la théorie de la relativité ? Bien la comprendre exige de modifier radicalement son rapport spontané au temps et à l’espace [7]. Apprend-on à lire ou composer des textes, qu’ils soient littéraires ou argumentatifs ? Ce n’est possible qu’en altérant en profondeur sa conception de la communication, voire de la vérité. Apprend-on à calculer une croissance démographique ? Cela force à faire siens, le temps du calcul au moins, des dizaines de présupposés sur la réductibilité du réel, et notamment des comportements humains, à des récurrences mathématisables. La manière dont on conçoit le temps, l’espace, la vérité et l’action humaine ne sont pas des actes strictement cognitifs, qui seraient sans conséquence sur notre rapport au monde et sur les positionnements éthiques qui nous restent ouverts.
Voici donc qu’instruire (sans même parler d’éduquer) semble bel et bien chercher à remplacer plusieurs caractéristiques centrales de la personnalité d’un individu (ses attitudes, ses façons de penser et d’agir, sa culture, sa vision du monde) par d’autres. Dans la mesure où ces caractéristiques ont une place au sein de ce qui définit l’individu, il s’ensuit que l’instruction consiste, entre autres, à transformer l’individu, c’est-à-dire à refuser ce qu’il est pour le faire devenir ce qu’il n’est pas. Autrement dit, le passage du premier sens de « vouloir que l’élève ne soit pas ce qu’il est » (à savoir « ignorant » ou « inéduqué ») au second (à savoir « cet élève avec sa personnalité et son rapport au monde ») n’est pas nécessairement sophistique. On a bel et bien besoin de souhaiter la disparition de ce qu’est l’élève pour lui permettre de n’être plus tel qu’il est. L’invalidité de l’argument de Dionysodore n’implique pas la fausseté de ce premier moment de sa conclusion.
Qu’en est-il du second ? Est-ce la mort de son élève que l’on souhaite ? L’inférence est en fait pure identification de l’expression « n’être plus ce qu’on est » avec « être anéanti », sans terme intermédiaire. Sa plausibilité dépend donc intégralement du sens dans lequel on entend « être anéanti ».
A) Dans le sens le plus courant, celui qui implique l’arrêt des fonctions vitales de Clinias, il n’y a aucun lien nécessaire entre les deux expressions : on peut cesser d’être ce qu’on est indépendamment du fonctionnement de son corps.
B) Si « être anéanti » signifie « il n’existe plus d’objet qu’on puisse mettre en continuité temporelle avec Clinias », c’est encore trop, car même si plusieurs déterminations essentielles sont remplacées, il suffit qu’il en reste une seule pour qu’il y ait continuité. Autrement dit, le souhait que Clinias ne soit plus ignorant peut certes être satisfait par la disparition intégrale de Clinias 1, mais aussi par d’autres cas de figure où il existe toujours quelque chose (Clinias 2) en continuité avec Clinias 1. L’argument de Dionysodore aurait alors pour seule valeur une mise en garde : veillons à ce que notre souhait que l’élève ne soit plus ce qu’il est contienne aussi une clause exigeant qu’il y ait toujours un élève (un Clinias 2) qu’on puisse considérer comme la version future de l’élève actuel (Clinias 1).
C) En revanche, si par « être anéanti », on entend quelque chose comme « il n’existe plus d’objet globalement identique à ce qu’on était », alors l’inférence est vraie mais triviale : éduquer un élève est le faire « mourir », au même titre que tout changement est une « mort ».
Ce deuxième moment de l’argument est donc soit un non sequitur (acception A), soit tautologique (acception C), soit partiellement vraie (acception B). Dans les deux premiers cas, il a peu de valeur au-delà du jeu éristique, dans le dernier, il peut au moins servir de point de vigilance pour l’éducateur.
Même un sophisme peut faire penser l’éducateur
Revenons donc à l’objection intuitive au raisonnement de Dionysodore (la raison 1). Peut-on souhaiter éduquer quelqu’un sans souhaiter sa mort ; arrive-t-on à enseigner sans tuer ses élèves ? Il reste clair que rares sont les parents et enseignants qui interrompent les fonctions vitales de leurs pupilles. Il est moins clair qu’ils puissent les éduquer sans les transformer profondément et, en ce sens, les faire « mourir ». C’est une simple question de mots jusqu’ici. Mais l’analyse de l’argument de Dionysodore permet de mettre le doigt sur deux points d’attention plus spécifiques.
D’une part, il y a dans toute entreprise éducative un refus de ce qu’est présentement l’élève ; il est nécessaire de l’assumer. Enseigner ou éduquer, c’est faire changer la personne, la faire cesser d’être telle qu’est est ; apprendre, c’est accepter de cesser d’être qui on est. Tout projet éducatif est volonté de rupture, en cela le lexique de la mort n’est pas complètement déplacé. Il est en tout cas plus approprié que l’euphémisme qui veut que l’on « acquière » (des savoirs, compétences, savoir-être ou de l’expérience). À vrai dire, même le schème platonicien de la réminiscence ne suggère pas aussi clairement la radicalité du changement provoqué par l’apprentissage, par ailleurs revendiquée par Platon1. L’argument de Dionysodore est un défi à l’hypocrisie de l’éducateur qui prétendrait faire du bien à son élève sans le contraindre à renoncer à au moins une part de lui-même.
D’autre part, Dionysodore va trop loin, dans la mesure où renoncer à une part de soi-même n’exige pas de devenir entièrement méconnaissable. Si tout changement est une mort, alors on peut mourir sous un certain rapport et survivre sous un autre. Devenir tout à fait autre, au point qu’il n’y ait aucune continuité entre l’élève avant et après son apprentissage, n’est qu’une des nombreuses options. Elle constitue néanmoins un risque réel : à vouloir faire de l’élève quelque chose de trop éloigné de ce qu’il est présentement, on se mettrait en position de vouloir que ce qui le définit n’existe plus du tout. Pour que l’éducation soit un acte d’amélioration plutôt que de remplacement, il importe de lui fixer un but en continuité avec ce que l’élève est actuellement.
L’art pédagogique doit voir loin, mais il ne peut prétendre vouloir le bien de cet élève que tant que le résultat escompté de la transformation éducative lui ressemble encore. En-deçà de ce point d’équilibre, il laisse l’élève pareil à lui-même, il ne l’éduque pas, ou guère. Au-delà, il le remplace par un autre, il le tue en un sens à peine métaphorique. Si le défi sophistique de Dionysodore à l’égard de Socrate et Ctésippe (et, à travers eux, de tout éducateur) peut nous alerter sur la nécessité et la difficulté d’un tel équilibre, il aura dit quelque chose d’utile, jusque dans son paralogisme, sur la relation éducative.
Notes
[1] Le terme grec est σοφός. Celui-ci peut se traduire de nombreuses manières, dont « sage », « habile » ou « savant ». Le choix entre ces nuances est sans importance ici : l’adjectif est contrasté avec ἀμαθῆ, « ignorant ».
[2] Platon, Euthydème, 283c-d : Καὶ ὁ Διονυσόδωρος, Σκόπει μήν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὅπως μὴ ἔξαρνος ἔσῃ ἃ νῦν λέγεις. – Ἔσκεμμαι, ἦν δ' ἐγώ· οὐ γὰρ μή ποτ' ἔξαρνος γένωμαι. – Τί οὖν; ἔφη· φατὲ βούλεσθαι αὐτὸν σοφὸν γενέσθαι; – Πάνυ μὲν οὖν. – Νῦν δέ, ἦ δ' ὅς, Κλεινίας πότερον σοφός ἐστιν ἢ οὔ; – Οὔκουν φησί γέ πω· ἔστιν δέ, ἦν δ' ἐγώ, οὐκ ἀλαζών. – Ὑμεῖς δέ, ἔφη, βούλεσθε γενέσθαι αὐτὸν σοφόν, ἀμαθῆ δὲ μὴ εἶναι; – Ὡμολογοῦμεν. – Οὐκοῦν ὃς μὲν οὐκ ἔστιν, βούλεσθε αὐτὸν γενέσθαι, ὃς δ' ἔστι νῦν, μηκέτι εἶναι.
Καὶ ἐγὼ ἀκούσας ἐθορυβήθην· ὁ δέ μου θορυβουμένου ὑπολαβών, Ἄλλο τι οὖν, ἔφη, ἐπεὶ βούλεσθε αὐτὸν ὃς νῦν ἐστὶν μηκέτι εἶναι, βούλεσθε αὐτόν, ὡς ἔοικεν, ἀπολωλέναι; Kαίτοι πολλοῦ ἂν ἄξιοι οἱ τοιοῦτοι εἶεν φίλοι τε καὶ ἐρασταί, οἵτινες τὰ παιδικὰ περὶ παντὸς ἂν ποιήσαιντο ἐξολωλέναι.
[3] L. Méridier, Platon. Œuvres complètes. Tome V, 1e partie: Ion - Ménexène – Euthydème, Paris, Belles Lettres, 1931, p. 125 et 160 met ces deux sens possibles en rapport avec les catégories aristotéliciennes de la qualité et de l’être. Ces deux catégories peuvent recouvrir l’opposition entre sens prédicatif et sens existentiel du verbe être, encore que la catégorie de l’être concerne l’essence d’une chose bien plus que sa simple existence.
[4] Il s’agit bien ici d’examiner la cohérence interne de ce que veut l’enseignant ou éducateur ; la question des effets réels de cette volonté dans la construction de la relation pédagogique n’a pas besoin de se poser à ce stade.
[5] Elle repose sur une conception « stricte » de l’identité à travers le temps, au sens développé par R. Chisholm, « The Loose and Popular and the Strict and Philosophical Senses of Identity », in N. Care et H. Grimm, Perception and Identity, Cleveland: Case Western Reserve University Press, p. 82–106.
[6] Ce dilemme sur la prise en compte des particularités culturelles des élèves (et de leurs familles) généralise en fait le problème de l’assimilation linguistique des minorités ; voir à ce sujet L. Delpit, Other People’s Children: Cultural Conflict in the Classroom, New York, New Press, 2006, notamment la p. 53.
[7] C’est en fait le cas de la plupart des modèles scientifiques. La physique newtonienne n’a rien d’intuitif, au point que de nombreux étudiants sont incapables d’utiliser efficacement une simulation simple de ses lois fondamentales, devant laquelle ils mobilisent en vain des stratégies de physique naïve, comme l’a étudié H. Gardner, The Unschooled Mind, New York, Basic Books, 1991, p. 150-155. Cette purification radicale des intuitions naïves pourrait même être le cœur de tout apprentissage rationnel, selon G. Bachelard, Le rationalisme appliqué, Paris, Presses Universitaires de France, 1949, p. 12-30.
Bibliographie
Bachelard, G., Le rationalisme appliqué, Paris, Presses Universitaires de France, 1949.
Burnet, J., Platonis Opera, Oxford, Clarendon Press, 1968 [1903].
Chisholm, R., « The Loose and Popular and the Strict and Philosophical Senses of Identity », in N. Care et H. Grimm, Perception and Identity, Cleveland: Case Western Reserve University Press, p. 82–106.
Delpit, D., Other People’s Children: Cultural Conflict in the Classroom, New York, New Press, 2006
Gardner, H., The Unschooled Mind, New York, Basic Books, 1991.
Méridier, L., Platon. Œuvres complètes. Tome V, 1e partie: Ion – Ménexène – Euthydème, Paris, Belles Lettres, 1931.