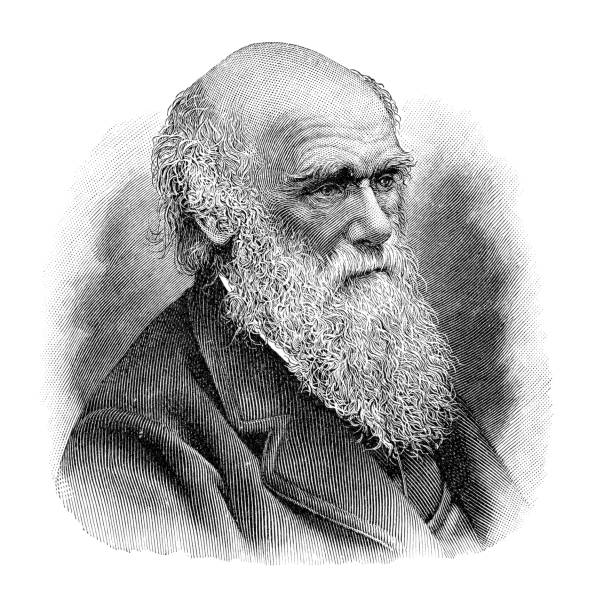INTRODUCTION
Euclide ou Newton ont laissé des traces durables dans l’histoire de la philosophie, et leurs œuvres enveloppaient réciproquement des convictions philosophiques. Mais il serait assez vain de vouloir identifier une philosophie euclidienne ou une philosophie newtonienne. Entre science et philosophie, la rapport est de dialogue plutôt que d’assimilation. Toutefois ce genre de propos n’est jamais clair qu’a posteriori: c’est à l’historien que la science et la philosophie apparaissent comme des types différenciés. Dans l’actualité des controverses, il n’en va pas de même: science et philosophie se mêlent inextricablement dans les actes de pensée. Cette situation est précisément celle du darwinisme dans la culture contemporaine. Nul ne peut dire en ce domaine où passent exactement les frontières entre science, idéologie, et philosophie.
Mon intention n’est pas ici de donner un tableau historique exhaustif des rapports entre science darwinienne et philosophie. Je n’ai pas non plus la prétention d’apporter des réponses philosophiques inédites aux défis que le darwinisme a adressés aux philosophes. Mon propos est plus modeste: je me propose, dans ce cas précis, d’illustrer la notion de dialogue entre science et philosophie, en cataloguant les espèces de ce dialogue, et en montrant en quoi la relation a bien consisté, ou consiste, en un dialogue. C’est pourquoi je m’interdis d’emblée d’admettre qu’il y aurait une “philosophie darwinienne”, ou des questions philosophiques “spécifiquement darwiniennes”. Sans doute un certain nombre de savants ou de philosophes se sont exprimés de la sorte, mais ce n’est là qu’une position dans un débat manifestement plus complexe.
Au lieu d’aller du darwinisme à la philosophie, je préfère aller en philosophe vers le darwinisme. Ma méthode reposera sur une suggestion élégante de Marjorie Grene. Dans son Testament philosophique2, récemment publié, la philosophe américaine estime que l’impact du darwinisme sur la philosophie devrait être évalué à la lumière des trois questions par lesquelles Emmanuel Kant définissait le champ propre de la philosophie: — que puis-je savoir? —Que dois-je faire? —Que m’est-il permis d’espérer?3 Ou encore, dans les termes du Cours de logique: les questions auxquelles répondent la métaphysique, la morale, et la religion. Dans ce même cours, Kant ajoutait que les trois questions se ramenaient en définitive à une seule question, « qu’est-ce que l’homme ? »4.
La suggestion de Marjorie Grene me paraît très féconde. Il se trouve en effet qu’historiquement, la vision darwinienne de l’évolution a conduit à des controverses et spéculations qui ont rencontré de facto les trois interrogations kantiennes. L’interférence avec la question religieuse est évidente: elle a plus que toute autre contribué à la popularité de Darwin. En ce qui concerne la question morale, les efforts pour construire une “morale évolutionniste”, clairement adossée au principe de sélection naturelle, se sont succédés sans repos depuis L’origine des espèces de Darwin. Quant à la question « Que puis- je savoir? », elle est au cœur d’un courant de pensée qui s’est développé dans le seconde moitié du vingtième siècle sous le nom d’“épistémologie évolutionniste”. Il n’est donc pas artificiel d’évaluer les enjeux philosophiques du darwinisme sous l’angle des trois questions kantiennes. Celles-ci ne seront au demeurant prises que comme des repères; mon intention n’est pas de confronter méthodiquement le darwinisme avec les doctrines particulières de Kant sur ces questions. Je laisse pour le moment de côté la quatrième question —la question anthropologique—, qui dans l’esprit de Kant résume les trois autres. J’y reviendrai dans ma conclusion.
DARWINISME ET RELIGION
Commençons par la troisième des questions qui, selon Kant, circonscrivent le territoire philosophique —« Que m’est-il permis d’espérer? » Cette question porte sur le bonheur accessible à l’homme. Mais, Kant pensant à l’espoir d’une vie future, c’est clairement de la religion qu’il s’agit.
Au risque de surprendre, je soutiens que la question du rapport du darwinisme à la religion ne constitue pas, et n’a pas constitué un enjeu philosophique important. J’avance à cet égard trois arguments.
Voici le premier. Si la religion a compté dans l’histoire du darwinisme, c’est à titre de controverse sociale, non comme objet d’une interrogation philosophique sérieuse. Du temps de Darwin, comme aujourd’hui encore, la vision darwinienne de l’évolution a menacé les individus et les groupes religieux qui ont valorisé l’interprétation littérale des récit bibliques de la création. De ce point de vue, la théorie darwinienne de l’évolution n’a fait que relancer un débat mainte fois soulevé depuis Galilée, tantôt à propos de la théorie du ciel, tantôt au sujet de l’histoire de la terre, tantôt au sujet de l’histoire de l’homme. Quelle qu’ait été, et quelle que soit l’ampleur des passions agitées par les thèses de Darwin sur l’origine des espèces vivantes, en particulier de l’homme, le débat philosophico- théologique sur l’interprétation des Écritures n’a rien eu de radicalement nouveau. S’il y a une quelconque spécificité de ce débat à l’époque contemporaine, c’est dans ses manifestations sociologiques ou politiques qu’il faut la chercher.
Mon second argument a trait à l’histoire intellectuelle du darwinisme après Darwin. Les grands biologistes darwiniens ont eu souvent à cœur de faire connaître publiquement leurs convictions sur le destin de l’homme et sur la religion. Or un rapide coup d’œil à ce genre de littérature montre qu’il n’y a pas eu de corrélation franche entre le fait d’être un biologiste darwinien et tel ou tel genre de conviction ou de réflexion particulière en matière de religion. Darwin est devenu athée relativement jeune, mais ne s’est jamais exprimé publiquement sur le sujet. Ernst Haeckel, principal propagandiste de Darwin en Allemagne, considérait que la théorie moderne de l’évolution allait de pair avec le monisme matérialiste, expression dont il est l’inventeur. Dans le même temps, le défenseur le plus ardent de la théorie de la sélection naturelle en Angleterre, Thomas Henry Huxley, créait le mot d‘“agnosticisme”, précisément dans le contexte d’une réflexion sur l’incidence de l’évolution sur la question religieuse. Au vingtième siècle, le tableau est plus pittoresque. Considérons par exemple les grands pionniers de l’interprétation génétique de la sélection naturelle: J.B.S. Haldane était marxiste et athée; Ronald Fisher était un anglican pratiquant, et voyait le sommet de son œuvre dans un théorème fondamental de la sélection naturelle qui exprimait l’aptitude irrésistible des espèces vivantes à contrer le second principe de la thermodynamique,; l’américain Sewall Wright était un presbytérien pratiquant, et tendait philosophiquement vers une sorte de panpsychisme. Quant à Theodosius Dobzhansky, le plus grand nom sans doute de la génétique des populations naturelles, et le plus orthodoxe des biologistes darwiniens du vingtième siècle, il n’a jamais dissimulé sa foi orthodoxe, et son admiration sans borne pour Teilhard de Chardin, auquel il a consacré un livre5, et bien des loisirs comme trésorier de la société américaine des amis de Teilhard. En France, les deux théoriciens majeurs de la sélection naturelle furent Georges Teissier et Philippe L’Héritier. Tous deux ont étroitement collaboré dans les années 1930 et 1941. Or Teissier fut l’un des intellectuels les plus influents du parti communiste français dans les années 1940 à 1960, tandis que L’Héritier s’est posé comme un intellectuel catholique. De semblables exemples pourraient être multipliés: ils montrent que les biologistes de l’évolution ne se sont sentis nullement contraints de faire front commun sur le terrain de la question religieuse.
J’en viens à un dernier argument, qui touche à la lettre même de la théorie de la sélection naturelle chez Darwin. En quoi cette théorie pouvait-elle affecter la philosophie de la religion? L’on sait que d’un bout à l’autre de L’origine des espèces, Darwin a présenté la sélection naturelle comme une explication de l’histoire de la vie plus cohérente que la théorie dite des « créations séparées ». Selon cette dernière théorie, Dieu serait intervenu spécialement pour créer successivement les espèces au cours de l’évolution. A cette conception, Darwin opposait un ensemble de lois naturelles susceptibles d’expliquer la modification des espèces et leur dérivation les unes à partir des autres. Or il est intéressant d’observer comment Darwin concevait l’impact de sa théorie de la sélection naturelle sur la question théologique.
Dans la première édition de L’origine des espèces, la dernière phrase du livre vient ainsi:
« Il y a une grandeur dans cette vision de la vie, avec ses puissances originellement insufflées à un petit nombre de formes, ou même à une seule: tandis que notre planète, obéissant à la loi fixe de la gravitation, continue à tourner, une quantité infinie de formes belles et admirables, n’ont cessé d’évoluer, et évoluent encore »6 (notre traduction).
Trois mois plus tard, dans la seconde édition, Darwin a introduit une légère modification, sur laquelle il ‘n’est jamais revenu dans les éditions ultérieures (la modification apparaît ci-dessous en caractères soulignés):
« Il y a une grandeur dans cette vision de la vie, avec ses puissances originellement insufflées par le Créateur à un petit nombre de formes, ou même à une seule: tandis que notre planète, obéissant à la loi fixe de la gravitation, continue à tourner, une quantité infinie de formes belles et admirables, n’ont cessé d’évoluer, et évoluent encore »7 (notre traduction).
Cette modification avait sans doute une signification stratégique: —il fallait ménager le lecteur pieux... Toutefois, l’on comprend mieux l’intention du naturaliste si l’on se reporte à l’ébauche de L’origine des espèces rédigée en 1844, à une époque où Darwin était déjà athée. Dans ce texte, gardé secret pendant quinze ans, la phrase conclusive de la première édition de 1859 était déjà là. Mais elle était précédée par un certain nombre d’autres phrases de nature proprement philosophique, et qui ont été supprimées dans le livre de 1859. Voici les plus significatives:
« L’idée que la production et l’extinction de formes sont, comme la naissance et la mort des individus, le résultat de moyens secondaires, s’accorde avec ce que nous savons des lois imprimées à la matière par le Créateur. C’est porter atteinte à la dignité du Créateur d’univers innombrables de penser qu’Il ait créé par des actes individuels de Sa volonté des myriades de parasites rampants et de vers, qui, depuis l’aube de la vie, grouillent sur la terre ferme et dans les profondeurs de l’océan. (...) Certes, notre première réaction est de rejeter l’idée qu’un loi secondaire ait pu produire des êtres organisés infiniment nombreux, caractérisés chacun par une exécution minutieuse et par des adaptations largement étendues: cela s’accorde mieux de prime abord avec nos facultés de supposer que chacun d’entre eux a exigé le fait d’un Créateur. Il y a une grandeur... »8.
La signification philosophique de ce texte est celle-ci. Darwin explique que, si l’on veut garder un rôle à Dieu dans l’histoire des formes vivantes, il est plus raisonnable de penser que le Créateur a agi par l’opération de causes secondes —autrement dit par des lois, que d’invoquer une succession de miracles. Il s’agit là d’un vieil argument philosophique, que Malebranche avait formulé avec élégance dès le dix-septième siècle, pour clarifier le rapport de la science à la religion: —la science n’a affaire qu’aux “causes secondes” (ou lois), non aux causes premières. Si donc la sélection naturelle est le nom d’une loi, ou d’un ensemble de lois, qui rendent compte de la genèse des formes vivantes, elle ne menace pas l’ordre des vérités révélées, car elle est du seul ordre de la nature. La conséquence évidente de cette opposition est que la théorie de la sélection naturelle est indifférente à la question religieuse.
J’arrêterai là l’examen du rapport entre darwinisme et religion. D’un point de vue philosophique, ce rapport n’a rien d’original. Tout au long des dix-septième et dix- huitième siècles, la question de la conception mécaniste de la Nature a été posée dans des termes semblables. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que la science darwinienne ait composé avec toutes sortes de convictions sur la question religieuse.
QUE DOIS-JE FAIRE? —L’ETHIQUE EVOLUTIONNISTE
Sur le sujet de la religion, nous n’avons guère assisté à un dialogue philosophique original. Sur le terrain de la question morale, les choses sont plus intéressantes. Je ne suis pas sûr que le darwinisme ait à cet égard suscité des problèmes radicalement nouveaux; du moins a-t-il renouvelé les débats sur l’approche naturaliste de la morale.
Commençons par ce que l’on a appelé, dès la seconde moitié du dix-neuvième siècle, la “morale évolutionniste”. Dans sa forme la plus traditionnelle, celle-ci consiste à inférer de l’évolution à la morale, autrement dit à ériger le principe de la lutte pour l’existence en fondement de la morale. On reconnaît ici le darwinisme social, qui n’est pas une création de Darwin, mais une élaboration de Spencer, relayé à la fin du dix-neuvième siècle par les pensées économico-politiques du laissez-faire. Mon objectif n’étant pas ici de nature historique, je me contenterai d’indiquer le principe de l’éthique évolutionniste. Schématiquement, l’éthique évolutionniste traditionnelle s’appuie sur deux prémisses. La première est que le monde organique est de facto en proie à la lutte pour l’existence. La seconde est que la concurrence vitale a produit au cours de l’évolution des organismes mieux adaptés, plus complexes, plus autonomes, autrement dit a été dans le sens d’un progrès. Cette seconde prémisse a l’allure d’un jugement de fait, mais elle est aussi un jugement de valeur. Elle permet donc aux adeptes du darwinisme social le passage du fait au droit: puisque la concurrence vitale a produit tant de belles choses au cours de l’évolution, il convient d’en faire une norme, donc de l’accepter et d’en favoriser le libre jeu parmi les hommes. L’éthique évolutionniste tiendra donc en un énoncé normatif fondamental: l’on a le devoir de préserver et de favoriser le processus même de l’évolution —le principe de compétition— dans l’administration des rapports entre les hommes.
A ce point, un dialogue contradictoire intéressant se met en place. L’on peut en effet formuler trois objections sérieuses à cette vision de la morale.
Il faut en premier lieu remarquer que l’on peut arriver exactement au même genre de prescription éthique sur une base totalement différente. La prescription du laissez-faire n’a pas attendu la théorie de l’évolution pour être formulée et élaborée. Toute la pensée utilitariste, dont Spencer héritait, aboutit aussi à l’idée qu’il est bon de laisser jouer la concurrence entre les individus: le libre jeu des intérêts individuels —disait-on depuis Adam Smith au moins— est la meilleure garantie du plus grand bien-être général. Toutefois, lorsque l’on raisonne ainsi, l’on présuppose des agents rationnels procédant à un calcul de leur intérêt. De tels agents conscients sont bien éloignés des organismes dont il est question dans la théorie de la sélection naturelle. L’on ne voit donc pas pourquoi il faudrait nécessairement passer par l’évolution biologique pour fonder la morale.
Une seconde objection classique à l’éthique évolutionniste se situe du côté de la théorie darwinienne de l’évolution même. Après tout, celle-ci n’implique pas l’idée d’un acheminement progressif et nécessaire de toutes les espèces vers un idéal de perfection objective. La sélection naturelle est foncièrement opportuniste et n’agit qu’à court terme: elle n’améliore les espèces que relativement aux conditions où elles se trouvent. Aussi la plupart d’entre elles se trouvent-elles un jour ou l’autre piégées dans des niches adaptatives, et disparaissent purement et simplement. Le modèle naturel sur lequel s’appuie l’éthique évolutionniste n’est donc pas convaincant. Sous hypothèse darwinienne, l’évolution ne va point uniformément dans le sens d’un progrès défini. Comme le note Michael Ruse, l’éthique évolutionniste s’appuie sur une interprétation erronée du progrès évolutif9.
Même si les deux objections précédentes étaient surmontées, il en resterait une, de nature logique, et probablement fatale. En inférant de l’évolution à l’éthique, l’on commet un genre de sophisme que David Hume avait clairement formulé dans son Traité de la nature humaine: le sophisme consistant à passer d’énoncés de fait à des énoncés prescriptifs, d’énoncés dont la liaison est établie par le verbe est ou n’est pas, à des énoncés dont la liaison est établie par doit ou ne doit pas10. D’innombrables savants et philosophes ont repris cet argument du « sophisme naturaliste », depuis les premières manifestations de la morale évolutionniste. Même si l’évolution darwinienne était un processus axiologiquement orienté, les êtres rationnels que nous sommes ne seraient pas dispensés de se demander si cette norme est bien la seule possible pour l’action humaine, et pourquoi il faudrait choisir celle-là plutôt qu’une autre.
Dans sa forme traditionnelle, l’éthique évolutionniste soulève donc de sérieuses objections philosophiques. Il existe cependant une autre forme de l’éthique évolutionniste, qui a ses sources dans la pensée même de Darwin11, et que l’on peut justement nommer « éthique darwinienne ». Elle part de l’idée selon laquelle les comportements moraux ne peuvent pas être compris seulement comme des produits de l’histoire culturelle, et reposent sur des dispositions construites par la sélection naturelle. L’homme apparaît alors comme un “animal éthique” dont les comportements coopératifs et altruistes de diverses sortes s’expliquent par leur valeur de survie présente ou passée. L’explication fait appel tantôt à des tendances innées (par exemple en matière de comportement parental), tantôt à l’idée d’un altruisme réfléchi, lié aux capacités de communication et de raisonnement de l’espèce humaine, dont il est peu probable qu’elles soient tombées du ciel. Ce genre de réflexion a d’abord été développé par Charles Darwin dans La descendance de l’homme. Un grand nombre de biologistes darwiniens ont repris, et parfois approfondi, cette interprétation adaptationniste des comportements humains. La plupart des synthétistes12 l’ont popularisée, dans les années 1950 et 1960. La sociobiologie humaine en est le plus récent avatar.
En quoi ce second genre d’“éthique évolutionniste” peut-elle concerner le philosophe, et plus particulièrement le moraliste? Laissons de côté les caricatures. Nous avons affaire à un secteur de science naturelle qui se donne pour objet d’expliquer les comportements moraux de l’homme. C’est là un programme de recherche empirique qui, a priori, n’est pas plus absurde que ceux de la psychologie expérimentale ou de l’anthropologie culturelle sur le même sujet, et qui a en fait vocation à coexister avec eux. La question importante pour le philosophe est de déterminer en quoi un tel programme peut concerner sa propre théorie de l’action morale. En particulier, en quoi l’idée de dispositions innées à certains comportement moraux affecte-t-elle la théorie philosophique de la morale?
Dans une publication récente, Michael Ruse a fait à cet égard une proposition provocante, mais intéressante d’un point de vue spéculatif. Il soutient que l’interprétation darwinienne de l’évolution des comportements moraux rend obsolète toute éthique fondationnelle, ou comme on dit souvent aujourd’hui toute “méta-éthique”:
« Je soutiens qu’une fois que l’on voit que l’éthique normative est simplement une adaptation mise en place par la sélection naturelle pour faire de nous des êtres sociaux, on peut voir aussi toute la naïveté qu’il y aurait à penser que la morale (...) ait un fondement. (...) La moralité, en tant que telle, n’a pas un statut plus justificateur que n’importe quelle autre adaptation, comme les yeux, les mains, ou les dents. (...) Cela ne signifie pas que l’éthique normative n’existe pas; elle existe à l’évidence. En revanche, cela signifie qu’il n’y a pas de fondement ultime »13
Nous touchons là une question philosophique importante. Admettons un instant la thèse soutenue par Ruse, et situons-la dans le champ de l’éthique philosophique traditionnelle. Du point de vue des fondements, il s’agit d’une position sceptique: il n’y a tout simplement pas sens à chercher un fondement à nos dispositions morales; il est plus sage de comprendre d’où elles viennent dans le passé de l’humanité et comment elles nous déterminent. En revanche, du point de vue de l’éthique normative, c’est-à-dire des prescriptions effectives de la morale dans les sociétés, la position de Ruse est le contraire d’une position sceptique. Il le dit lui-même en des termes crus: « ...l’essentiel, pour la morale, la morale normative s’entend, c’est qu’elle ne fonctionne qu’à la condition que nous ayons en elle une croyance absolue »14. C’est là une affirmation qui rejoint une très vieille idée, populaire autant que philosophique, selon laquelle que la morale est quelque chose qu’il est plus important de mettre en pratique que de formuler (elle est, comme disent les philosophes un éthos). Dans son livre intitulé Éthique et médecine, Peter Kemp a souligné cette idée et l’ a illustrée par un exemple éloquent: « durant la guerre du Vietnam un officier avait remarqué (....) que les soldats les plus instruits qui se réclamaient souvent des principes moraux étaient également capables d’expliquer rationnellement et de façon précise les comportements les plus cruels. En revanche, les soldats ordinaires, d’instruction moyenne, distinguaient parfaitement les missions qu’ils jugeaient acceptables de celles auxquelles ils se refuseraient »15.Cette anecdote, qui vise à convaincre de l’idée que la morale est un éthos, pourrait aussi bien illustrer la thèse darwinienne de l’“animal éthique”. Cette thèse darwinienne nous ramène donc, sous un habillage nouveau, à une vision naturaliste de l’éthique somme toutes assez traditionnelle. Je m’en tiendrai pour le moment à cet état des lieux de l’éthique évolutionniste, et me réserve de formuler une réserve critiuqe dans ma conclusion générale.
QUE PUIS-JE SAVOIR? —L’EPISTEMOLOGIE ÉVOLUTIONNISTE
Il nous reste à évaluer l’incidence du darwinisme sur la première des questions kantiennes: « que puis-je savoir? » ou, ce qui revient au même: —quels sont les bornes du pouvoir humain de connaissance? A cette question, un secteur assez actif d’industrie darwinienne, communément désigné sous le nom d’”épistémologie évolutionniste” [evolutionary epistemology], s’est efforcé de répondre à sa manière. C’est sans doute sur ce terrain que la littérature authentiquement philosophique d’inspiration darwinienne a été la plus abondante. Mon objet n’étant ici que de dresser une carte, je me contenterai de situer les entreprises rassemblées sous le nom d’épistémologie évolutionniste.
L’expression a eu deux sens assez différents, quoiqu’ils aient été souvent confondus dans la littérature, en particulier en conséquence d’un dialogue mémorable entre Karl Popper et Konrad Lorenz, pionniers des deux variétés. L’épistémologie évolutionniste a en fait connu un développement assez comparable à celui de l’éthique évolutionniste. Dans la section précédente, nous avons rencontré deux sens de cette dernière expression. Chez Spencer et chez les adeptes du laissez-faire, l’éthique évolutionniste consiste à construire un parallèle entre l’évolution organique et le comportement social des hommes. Dans l’anthropologie darwinienne en revanche, il ne s’agit pas de construire une analogie entre histoire naturelle et histoire sociale, mais d’expliquer les comportements moraux dans le cadre de la théorie de la sélection naturelle. De la même manière, l’épistémologie évolutionniste a historiquement consisté en deux programmes passablement différents. Tantôt il s’est agi de construire une théorie de l’évolution de la connaissance scientifique fondée sur l’idée qu’elle est déterminée par un mécanisme de même nature que la sélection naturelle. Tantôt il s’agit de comprendre l’évolution biologique des systèmes cognitifs, et d’en tirer des leçons pour la théorie de la connaissance et éventuellement, mais non exclusivement, pour la philosophie des sciences. Par conséquent, le projet de l’épistémologie évolutionniste a consisté soit à transposer le mécanisme de sélection naturelle dans la sphère de l’évolution culturelle, soit à faire jouer le principe de sélection naturelle stricto sensu pour la compréhension des contraintes qui pèsent sur les systèmes cognitifs animaux en général, et humain en particulier.
Considérons d’abord l’épistémologie évolutionniste dans sa version métaphorique. Il s’agit d’un courant qui a son origine dans une proposition du philosophe des sciences Stephen Toulmin, formulée dans les années 196016. Toulmin a soutenu que l’évolution conceptuelle de la science est objectivement produite par un processus de sélection. De nombreux philosophes, dont Karl Popper17, ont ensuite emboîté le pas, et l’on ne compte plus les études qui se sont efforcées de définir et d’approfondir de manière précise le parallélisme entre évolution organique et évolution conceptuelle de la science. Le philosophe qui a été le plus loin dans cette voie est probablement David Hull, dans un livre paru en 1988 sous le titre La science comme processus18. David Hull soutient que le changement scientifique peut être vu comme un processus de sélection d’éléments tels que des problèmes et leurs solutions possibles, des données, des croyances sur le but de la science. Ces éléments, dont le rôle est analogue à celui des gènes dans la théorie de l’évolution biologique, sont répliqués dans des conversations, des livres, des publications, des cerveaux humains. Par ailleurs, ils interagissent indirectement, avec les portions du monde auxquels ils se réfèrent, par le biais d’actes matériels et communicatoires réalisés par les scientifiques. Des variants surgissent, qui ont un taux de diffusion, dans des conditions de milieu scientifique données, et se prêtent donc à une caractérisation dans le langage de la sélection naturelle. La littérature montre que le parallèle peut être mené très loin, et que l’on peut véritablement construire un concept général de la sélection naturelle, qui s’applique à la fois à l’évolution organique des espèces et à l’évolution culturelle de la connaissance scientifique. Totalement spéculatif au départ, ce genre d’épistémologie évolutionniste a toutes chances dans le futur de s’incorporer dans l’arsenal d’une sociologie quantitative, ou épidémiologie des sciences. Le programme de recherche est d’ailleurs généralisable à l’ensemble de l’histoire culturelle. Quoi qu’il en soit, c’est comme programme d’investigation empirique qu’il faudra juger l’épistémologie évolutionniste, pour autant que la méthode donne des résultats, et permette effectivement de mieux comprendre l’histoire effective des sciences, ce qui n’est aucunement acquis à l’avance.
Quant à l’enjeu philosophique sous-jacent, il n’est pas bien difficile à discerner. Soutenir que la dynamique du changement scientifique est portée par un processus rigoureusement analogue à la sélection naturelle, c’est en effet estimer que le développement de la science, observé à une échelle temporelle et collective appropriée, est tout aussi erratique, opportuniste et contingent que l’évolution organique des espèces, et qu’il est cependant justiciable d’une analyse causale. Nombreux sont les sociologues qui sont aujourd’hui sensibles à la possible fécondité des méthodes de la biologie populationnelle pour la compréhension de l’histoire sociale humaine.
L’autre pôle de l’épistémologie évolutionniste a une origine plus ancienne, communément attribuée à un article publié par Konrad Lorenz dont le premier remonte à 1941. Il s’agit d’un texte dans lequel le biologiste autrichien a proposé de réinterpréter la notion kantienne d’a priori à la lumière de la biologie contemporaine19. De manière générale, l’épistémologie évolutionniste développée dans le sillage de Lorenz vise à expliquer l’existence et la diversité des systèmes cognitifs animaux à partir de leur valeur de survie, dans des niches écologiques définies. Dans le cas de l’homme, il s’agit d’un programme de recherche qui est moins intéressé par la science que par les universaux biologiques qui dans l’espèce humaine structurent la perception et la connaissance. D’où son intérêt prioritaire, par exemple, pour les illusions perceptives, pour la communication familière et pour la logique naïve. Des études approfondies ont été ainsi consacrées aux schèmes transculturels de classification ou de causalité20, dont la valeur adaptative a sans doute été immense dans l’histoire de l’humanité, même s’ils nous posent aujourd’hui de sérieux problèmes dans des secteurs de science peu intuitive. Entendue comme étude de l’évolution des systèmes cognitifs, l’épistémologie évolutionniste est donc une recherche qui a pour ambition de nous renseigner sur « l’origine, la structure, la fiabilité et les limites de notre appareil de connaissance »21. On parle souvent de la thèse “limitationniste” inhérente à ce programme de recherche (idée de limitations à notre pouvoir de connaissance pour des raisons tenant aux contraintes “méso-cosmiques” qui ont encadré son évolution).
CONCLUSION
Je crois avoir présenté un panorama vraisemblable des manières dont le darwinisme a affecté la philosophie. Il est temps de tirer un bilan. Selon la perspective où l’on se placera, le bilan du dialogue de la science darwinienne avec la philosophie pourra paraître maigre ou impressionnant.
Il est maigre pour qui attendrait de la science darwinienne de l’évolution qu’elle ait radicalement renouvelé tel ou tel secteur d’interrogation philosophique. En ce qui concerne le rapport du darwinisme à la religion, nous avons montré que rien de bien nouveau n’était apparu sous le soleil philosophique; c’est l’inscription sociologique du débat, non son contenu philosophique qui mérite d’être retenue. Sur le terrain de la réflexion éthique, le darwinisme nous a donné occasion de réfléchir en des termes nouveaux sur l’ancrage naturel possible des comportements moraux. Sans doute le genre d’explication offert par la théorie darwinienne de l’évolution est-il inédit, mais l’interrogation philosophique sur le fondement de la morale n’est pas foncièrement renouvelé: comme d’autres approches naturalistes de la morale, le traitement darwinien, dans ses versions les plus cohérentes, récuse l’idée d’un fondement de la morale, et n’admet qu’un discours sur les origines. Enfin, c’est peut-être sur le terrain de la connaissance que le dialogue, quoique tardif, a été le plus fécond: dans ses deux versions, l’épistémologie évolutionniste a ouvert des champs d’investigation inédits. Mais elle n’épuise pas, loin de là, le champ des questions épistémologiques.
Toutefois ce même bilan peut impressionner. Y a-t-il eu, dans l’histoire moderne, beaucoup de théories scientifiques, pour susciter un questionnement philosophique durable tout à la fois sur la religion, la morale et la connaissance, et cela sans appartenir au champ des sciences humaines? —Je ne le crois pas. C’est peut-être ici qu’il faut se souvenir de la quatrième question à laquelle, selon Kant, toutes les interrogations proprement philosophiques peuvent se ramener: la question anthropologique (« qu’est-ce que l’homme? »). La science darwinienne de l’évolution, si elle n’a pas l’homme pour objet spécifique, est cependant une science naturelle qui a beaucoup à dire sur la nature de l’homme. Il n’est donc pas étonnant que dans une ère philosophique dominée par l’anthropologie, le dialogue avec cette sorte de science ait été, sinon toujours fécond, du moins inévitable.
Je voudrais maintenant clore par une observation critique sur les deux entreprises de l’éthique et de l’épistémologie évolutionnistes. En quoi ces deux dérives naturalistes de la philosophie peuvent-elles susciter la réserve du philosophe? La catégorie de relativisme peut nous être ici utile. La vision darwinienne de l’homme aboutit en général à discréditer le relativisme, tant dans la sphère cognitive que dans la sphère morale. Si en effet nos dispositions à connaître et à agir sont d’abord vues comme le fruit d’une longue évolution de l’espèce, les différences relevées par l’anthropologie culturelle pourraient bien n’être au fond que très superficielles. Le naturalisme darwinien, si on l’admet, est assez fatal au relativisme anthropologique: « les gènes tiennent la culture en laisse », pour reprendre une formule fameuse d’Edward O. Wilson22.
Je ne pleurerai pas quant à moi sur la déroute du relativisme anthropologique, qui ne me semble guère avoir d’avenir ni pour l’histoire naturelle ni pour l’histoire culturelle de l’humanité. Toutefois le philosophe, comme l’a rappelé récemment l’anthropologue Dan Sperber, reconnaît une autre sorte de relativisme, le relativisme métaphysique. « Dans le domaine cognitif —écrit Sperber—, le relativisme métaphysique consiste à soutenir qu’il existe non pas une, mais plusieurs vérités incompatibles entre elles. (...) Dans le domaine moral, [il] consiste à soutenir qu’il existe non pas un bien, mais plusieurs biens incompatibles entre eux »23. Ce relativisme-là, comme son nom l’indique, est sans doute constitutif du dialogue philosophique. Point de philosophie, discipline tout à la fois normative et critique, s’il n’existe pour les êtres rationnels que nous sommes, des représentations incompatibles des biens et des vérités possibles. Si nous n’étions que ces animaux cognitivement et moralement incorrigibles dont le naturalisme darwinien nous renvoie l’image, il nous serait bien difficile d’avoir ne serait-ce que la présomption d’une incommensurabilité des vérités et des biens possibles. D’où je tirerai, en conclusion, l’adage suivant: —même si notre pouvoir de connaissance et notre pouvoir d’agir sont biologiquement limités, nous ne sommes pas pour autant contraints d’en inférer que ces limites devraient être les normes du vrai et du bien.
Notes de bas de page:
- Professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
- Marjorie GRENE, A Philosophical Testament, Chicago & La Salle (Ill.), Open Court, 1995, pp. 107-112.
- Emmanuel KANT, Critique de la raison pure [1781], Méthodologie transcendantale, Chap. 2, section 2.
- « ...la philosophie ... est la science du rapport de toute connaissance et de tout usage de la raison à la fin ultime de la raison humaine, fin à laquelle, en tant que suprême, toutes les autres fins sont subordonnées et dans laquelle elles doivent être toutes unifiées. Le domaine de la philosophie en ce sens cosmopolite se ramène aux questions suivantes: 1) Que puis-je savoir? 2) Que dois-je faire? 3) Que m’est-il permis d’espérer 4) Qu’est-ce que l’homme? A la première question répond la métaphysique, à la seconde la morale, à la troisième la religion, à la quatrième l’anthropologie. Mais au fond, on pourrait ramener tout à l’anthropologie, puisque les trois premières questions se rapportent à la dernière ». (Emmanuel KANT, Logique, trad. fr par L. Guillermit, Paris, Vrin, 1966, p. 25).
- Theodosius DOBZHANSKY, The Biology of Ultimate Concern, Chicago, Meridian, 1967.
- The Origin of Species by Charles Darwin—A variorum Text, Morse PECKHAM (ed.), Philadelphia, Un. of Pennsylvania Pr., 1959, p. 759.
- Ibid.
- Charles Darwin—Ébauche de l’origine des espèces (essai de 1844), traduction de Charles LAMEERE, revue complétée et annotée par Daniel BECQUEMONT, Lille, Presses Universitaires de Lille, 1992, pp. 192-193.
- Michael RUSE, « Une défense de l’éthique évolutionniste », in Fondements naturels de l’éthique, ss la dir. de Jean-Pierre CHANGEUX, Paris, Odile Jacob, 1993, pp. 35-64.
- David HUME, Traité de la nature humaine, III, I, 1. Trad Leroy, p. 585. La qualification de cet argument comme « sophisme naturaliste » [Naturalistic fallacy] est due à G.E. MOORE, Principia Ethica, Cambridge, Cambridge University Press, 1903.
- Charles DARWIN, The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. London, J. Murray, 2 vols. Trad. fr. par E. BARBIER, La descendance de l’homme et la sélection sexuelle, Paris, C. Reinwald & Cie, 1872. Voir surtout la première partie, chap. III à V.
- En particulier: Bernard Rensch, Julian Huxley, Theodosius Dobzhansky, Conrad H. Waddington, George G. Simpson, G. Ledyard Stebbins.
- Michael RUSE, ibid., pp. 58-60.
- Michael RUSE, ibid., p. 62.
- Peter KEMP, Éthique et médecine, traduit du danois par Else-Marie Jacquet-Tisseau, Paris, Tierce, 1990, chap. “Le fondement de la morale dans l’éthos”, pp. 29-30.
- S. TOULMIN, « The evolutionary development of natural science », American Scientist, 57 (1967), pp. 456-471; Human Understanding, Osford, Oxford University Press, 1972.
- Karl POPPER, Objective Knowledge, Oxford, Oxford University Press, 1972. En réalité, la reconnaissance par Popper du fait que son interprétation du changement scientifique est sélectionniste est explicite dès La logique de la découverte scientifique [1re éd. allemande: 1934].
- David HULL, Science as a Process. An Evolutionary Account of the Social and COnceptual Development of Science, Chicago, The University of Chicago Press, 1988.
- Konrad LORENZ, « Kant’s Lehre vom Apriorischen im Lichte gegenwärtiger Biologie », Blätter für Deutsche Philosophie, 15 (1941), pp. 94-124. Trad. angl. ss le titre: « Kant’s doctrine of the a priori in the light of contemporary biology », General Systems, 7 (1962), pp. 23-35. Gerhard Vollmer donne une analyse du courant de pensée qui en est né dans « What evolutionary epistemology is not », in Werner CALLEBAUT and Rik PINXTEN (eds), Evolutionary Epistemology. A Multiple Paradigm, D. Reidel, 1987, pp. 203-221.
- Voir par exemple Scott ATRAN, Fondements de l’histoire naturelle. Pour une anthropologie de la science, Bruxelles, Éditions Complexe, 1986.
- Gerhard VOLLMER, loc.cit., p. 218.
- Edward O. WILSON, L’humaine nature, Paris, Stock, p. 243.
- Dan SPERBER, « Remarques anthropologiques sur le relativisme moral », in Fondements naturels de l’éthique, ss la dir. de Jean-Pierre CHANGEUX, Paris, Odile Jacob, 1993, p. 320.